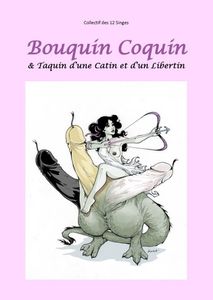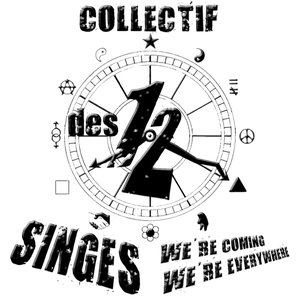Des chefferies lignagères aux villes métissées
Télécharger le fichier : 09-Les aubes des dogmes et leurs Contestations.pdf
Les premières cités apparaissent vers la fin du -IVè millénaire. Comment et pourquoi passe-t-on du village de
quelques milliers d’âmes, aux sanctuaires modestes et aux maisons relativement identiques, à des villes dix fois plus peuplées et étendues (certaines agglomérations s’étendent sur une centaine
d’hectares et peuvent compter plus de 10 000 habitants), dotées d’un temple monumental, d’un palais, de quartiers d’habitation et d’ateliers, d’entrepôts, d’un port et d’une enceinte ?
Dans le courant du -Vè millénaire, la diminution des pluies d’été affecte profondément la vie pastorale. Les humains cherchent alors à se rassembler là où l’eau demeure en abondance : dans le
delta de la vallée du Nil, dans la basse Mésopotamie et la Susiane (Iran), dans la vallée de l’Indus.
Les conséquences de ce repli vont être lourdes de conséquences sur le plan social : les structures familiales ou claniques (plusieurs familles affiliées) font place à des structures tribales
(différentes familles qui ont moins de liens entre elles) de plus en plus complexes.
Certaines communautés villageoises particulièrement dynamiques ont bâti en quelques centaines d’années une
civilisation urbaine, inventant non seulement un nouveau mode de vie, mais aussi une nouvelle manière de voir le monde et de l’aménager. La naissance des villes et l’essor démographique furent
liés à l’existence d’organisations communes qui avaient mûri dans le sud de l’Irak depuis plusieurs centaines d’années, à partir de -4 300. L’organisation sociale de ces communautés villageoises
était adaptée aux exigences de l’agriculture irriguée. De puissants lignages se structurèrent au -Vè millénaire en chefferies.
Les problèmes sociaux issus de la densité de population furent résolus d’abord par le développement des villes : vers -3 000, sur un territoire grand comme la Suisse, existent le long de trois
grands chenaux de l’Euphrate et du Tigre une série de micro-états (une quinzaine), qui exploitent chacun une partie du réseau.
En quelques millénaires (du -VIIè au -IIIè millénaire), de simples communautés villageoises se sont
progressivement développés jusqu’à inventer l’état. Entre les sociétés villageoises du -Vè millénaire et des états dotés d’une administration, d’une armée et des attributs du pouvoir centralisé,
le monde mésopotamien offre l’exemple d’une évolution remarquable : on passe en un peu plus d’un millénaire de la Préhistoire à l’Histoire.
Cette dynamique exceptionnelle (on ne connaît que cinq autres foyers du même genre sur l’ensemble de la planète : chinois vers -8 500, néo-guinéen vers -10 000, nord-américain vers -4 000, centre
américain vers -6 500, sud-américain vers -7 000) a différents facteurs.
Les premiers foyers de civilisation seront dans les régions riches en eau : le delta et la vallée du Nil, la vallée de l’Indus, la basse Mésopotamie et la Susiane, porte de l’Iran. Ainsi,
l’espace agricole est naturellement confiné par le désert, par la mer ou par des montagnes. Normalement, les sociétés villageoises se scindent et essaiment, au lieu de se transformer, épuisant
ainsi leur vitalité en expansion territoriale (ce qui permet de contrôler le fonctionnement et l’organisation de la communauté, en empêchant l’émergence d’une puissance coercitive pour gérer le
nombre, protégeant au contraire la notion de « conseil de village », sans véritable chef mais plutôt leaders d’opinion). Des groupes humains étroits sont parfaitement viables, et les communautés
préfèrent éclater, plutôt que d’affronter les problèmes que poserait leur élargissement. Cette tendance générale ne s’inverse que si la pratique agricole demande un investissement plus poussé et
une collaboration plus étendue qu’à l’ordinaire.
Privés de mobilité horizontale, la population croissante n’a d’autre issue que de se tourner vers l’intensification de la production, la concentration de l’habitat et finalement l’organisation
politique pour gérer tout ceci. Dans ce cas seulement les gens restent ensemble et sont donc conduits à s’organiser, dans les domaines politique, social et idéologique, pour gérer un corps social
en continuelle expansion.
Pour autant, les communautés qui conservent leur acquis et taille démographique pour faire face aux difficultés que pose l’environnement (comme auparavant les chasseurs-collecteurs de l’ère
glaciaire), passaient par des techniques de régulation de la population (par la contraception médicinale voire l’avortement – par intrusion vaginale ou consommation de plantes –, si ce n’est par
l’infanticide). La problématique est ici que les gens cherchent à avoir autant d’enfants que possible (notamment à cause de la mortalité infantile), pour les aider tant qu’ils sont actifs, pour
les entretenir ensuite.
Cette dynamique a un caractère relativement, irréversible (même si on a vu des retours au nomadisme ou au moins semi avec la reconversion de certains vers le pastoralisme) car, lorsque s’est
constitué au fil des siècles un réseau d’irrigation de plus en plus étendu et performant (permettant la survie de ces agglomérations « obligatoires »), nul ne peut espérer se passer d’un tel
héritage sans remettre radicalement en cause son mode de vie.
Au-delà même de la pratique agricole, le système social qui s’est mis en place implique des réseaux de parenté irremplaçables (c’est la couverture sociale de l’époque, avec la garantie entre
autres de trouver un conjoint pour procréer de futurs aides de champs), une structure politique capable d’assurer l’ordre et la sécurité, des monuments qui sont l’expression même de la prospérité
Commune.
Tous ces avantages, réels ou subjectifs, sont propres à dissuader de partir tandis qu’à l’inverse, les agglomérations les plus importantes (les plus prospères, les mieux organisées, celles qui se
sont dotées de bâtiments les plus impressionnants) constituent des pôles d’attraction vers lesquels convergent les populations des campagnes environnantes. Avec le temps, les communautés
s’amplifient encore et la hiérarchie s’accentue. On aura bientôt affaire à des micro-états, gouvernés par une élite à la tête de laquelle se trouve un seigneur.
Uruk (-4 300 à -3 100) était au cœur d’un vaste réseau de relations et d’échanges dont le développement est
étroitement lié aux mutations que connaît alors l’ensemble du monde mésopotamien.
Uruk était le centre très actif d’un important réseau de villages et de petits bourgs situés le long des chenaux de l’Euphrate. Le développement d’un aussi grand centre reposait sur les
ressources agricoles des villages situés en amont de la ville. Les grains, accumulés dans les greniers des centres urbains, y arrivaient par voie fluviale. Là, les grandes maisonnées sumériennes
redistribuaient sous forme de rations ces céréales à des artisans et aux personnels spécialisés d’unités de production variées. Les céramiques préhistoriques souvent décorées de motifs complexes
étaient faîtes à la main dans un cadre domestique, peut-être féminin. On observe à partir de -4 500 d’importantes mutations : le développement de formes standardisées, une simplification des
décors peints, puis leur disparition, la manufacture de vases au tour de potier.
Toute la chaîne opératoire de production des céramiques s’adapte à des besoins nouveaux : la distribution de rations alimentaires nécessite la fabrication en série de bols puis d’écuelles
grossièrement moulées.
Ces différentes formes de céramique montrent le développement de toute une série de filières économiques nouvelles : l’exploitation et la transformation de produits laitiers, la production de
bière et de vin, qui sont autant de marques d’une révolution agroalimentaire aussi importante par son ampleur que la révolution néolithique.
A partir du début du -IVè millénaire, la production textile se développe. Jusque-là essentiellement issue de
l’exploitation du lin, la production s’oriente vers la transformation de la laine fournie par de grands troupeaux qui pâturent dans les marécages du pays de Sumer, voire dans les steppes de
Haute-Mésopotamie. A la fin du -IIIè millénaire, on estime que le pays de Sumer avait un cheptel de 540 000 moutons, que des villes comme Girsu ou Ur employaient 15 000 femmes dans la production
textile. On comprend donc pourquoi on a lié la révolution urbaine à une croissance démographique que la rente agraire de Sumer rendait possible. En effet, installées sur les bras du cours combiné
du Tigre et de l’Euphrate, les cités sumériennes exploitent au prix d’un effort humain limité les ressources exceptionnellement riches d’une niche écologique, un immense delta, qui offre
d’abondantes ressources de poissons, des roseaux et l’eau de l’irrigation.
De plus, les pluies de moussons affectaient jusque vers -3 500 le pays de Sumer. En revanche, à partir de cette époque, les conditions climatiques actuelles (aridité extrême) se mettent en place,
et ces modifications climatiques ont pu nécessiter un encadrement accru des populations. En même temps, cette dessiccation aurait aussi dégagé d’immenses espaces qui auraient alors été mis en
culture par irrigation.
La Mésopotamie offre une plateforme ouverte sur deux immensités : l’Orient et l’Occident, qui lui étaient
également accessibles : de fait, elle est soumise à tous les flux de circulation.
Elle constitue un ensemble cohérent, mais ne peut s’organiser d’abord sur des frontières naturelles intérieures : tout favorise donc l’éclosion de cités rivales, délimitant leur territoire autour
de pôles citadins centralisés. La région, plus riche que fertile, ne dispose pas de matières premières : du limon, du bitume, des roseaux, rien d’autre. Bref, nous disposons là de tout un
faisceau de contraintes qui expliquent en partie son dynamisme. Ce peuple mésopotamien doit donc circuler, commercer, voyager (aussi bien aux Indes qu’aux marches de l’Europe), et il suppléé ses
carences naturelles par des trouvailles techniques et intellectuelles. Les Sumériens, venus peut -être par la mer du golfe Arabo-persique, semblent avoir coupé les ponts avec leur patrie
d’origine. Les Sémites en revanche s’enracinent dans un puissant arrière-monde, remontant jusqu’à la Syrie. Plus dynamiques, plus nombreux, constamment alimentés de sang frais, même s’ils
semblent avoir été moins inventifs, ils « décollent » grâce à leur contact avec les Sumériens. Réciproquement, les Sumériens profitent de l’extraordinaire vitalité des Sémites. Il faut aussi
compter sur d’autres Peuples, déjà présents sur les lieux, qui nous ont légué de nombreux noms propres tels que Lagash, Uruk, Ur. Nous sommes donc en présence d’une civilisation dynamique,
composite. Le choc de l’écriture va la précipiter (dans le sens chimique du terme) dans un double mouvement : l’organisation d’une mythologie et celle, complémentaire, d’un certain esprit «
scientifique », les deux se liant.
Les cités échangeaient ainsi les produits issus de leur système économique de production, notamment les
textiles, contre des matières premières qui faisaient défaut dans le sud irakien, notamment le bois, les pierres précieuses et les métaux.
Le dense réseau des chenaux de l’Euphrate et du Tigre, qui formait au -IVè millénaire un ensemble unique, était la ligne de vie du pays de Sumer.
Alors que l’on avait affaire à une gestion très poussée dans le cadre des chefferies, on passe avec l’urbanisation à un contrôle de plus en plus absolu des productions et des échanges. Le terme
gestion est plus neutre car il ne présume pas d’objectifs. L’idée d’organisation y est implicite et par-là même celle de prises de décision, au moins individuelles, voire au niveau du groupe,
supposant alors une volonté ou un objectif communs. Le terme contrôle, quant à lui, contient l’idée d’objectifs à atteindre, de maîtrise, de domination et donc de pouvoir sur les choses ou les
êtres. Le seigneur de la cité a alors quasiment un droit de propriété sur ses possessions, ses femmes, ses subordonnés. Le fait de disposer de gens, fidèles et dévoués, est un instrument de
pouvoir efficace sur le reste de la société.
Dès le -IVè millénaire, à l’époque dite d’Uruk, la plaine alluviale est partagée en une série de petites
principautés indépendantes que l’on appelle des cités-états parce que la population tend à se concentrer dans de vastes agglomérations à caractère urbain, même si la base économique reste
fondamentalement agricole. Le passage au mode de vie urbain marque un changement profond. On voit apparaître alors des individus dont la fonction manuelle est masquée par l’activité verbale ou
intellectuelle au sens le plus large : marchands, scribes, bientôt les prêtres.
La mutation décisive de l’urbanisation s’est produite avec le site d’Uruk (V-IV, vers -3 500) en basse Mésopotamie (du Sud). La ville est plus qu’une agglomération de maisons, de rues et de
monuments. Elle s’étend sur près de 200 hectares, entourée d’une longue muraille de près de dix kilomètres (construite selon la légende par Gilgamesh lui-même), et abrite environ 40 à 50 000
personnes.
Dans un système fondé sur la concentration, la ville est un noyau humanisé, un paysage artificiel.
Une ville est un lieu où les habitants se considèrent comme des citadins. Derrière la boutade, il y a une réalité. De grosses agglomérations paysannes ne sont pas des villes : une cité est
caractérisée par la diversité sociale de ses habitants. Ces citadins, comme ceux qui, autour de la ville, assurent sa subsistance, instaurent entre eux des relations d’un type nouveau : la cité
est la tête et le centre d’un nouveau système social. Le monde « civilisé » (en terme étymologique) ne peut fonctionner sans ces cités : la ville est un centre de relations et de décisions où se
rencontrent les humains, où s’échangent les marchandises et où se diffusent les idées. C’est l’endroit où se rassemblent des formes d’activités différenciées, se distinguant du village par le
nombre des fonctions qu’elle remplit. C’est donc un système d’habitat particulier, concentré, qui permet à une société complexe de résoudre des problèmes spécifiques qui ne peuvent être réglés à
l’échelon individuel ou familial.
Les relations de dépendance personnelle apparaissent comme antérieures à l’état et jouent un rôle fondamental dans son émergence. Il y a une différence colossale entre un citadin-citoyen et un
parent (dans le cadre d’une chefferie lignagère) : la relation seigneur-citoyen est une relation totale, non partagée. Les parents sont des partenaires, avec des droits et des devoirs
réciproques, tandis que dans le cas du citoyen, tout est dans la main du seigneur.
La seconde composante de cette relation est la fidélité. Nous voyons toujours la servitude comme une condition contrainte, pleine de ressentiment envers le maître. Ce n’est souvent pas vrai : les
citoyens que l’on garde sont fidèles, les autres sont relégués auprès du bas Peuple. Le citoyen est donc souvent plus attaché à son maître que le subordonné libre ou le parent, car c’est à ce
prix qu’il a une place, éventuellement importante, dans la société où il vit.
A Uruk V et IV (vers -3 500), de grandes constructions s’élèvent. Les plans dérivent de ceux de l’époque d’Obeid, mais les dimensions s’hypertrophient (jusqu’à 80 m de long), l’ornementation est
recherchée (décor de niches et pilastres compliqués, parure de mosaïque). Ces bâtiments ne sont pas disposés au hasard, mais souvent groupés deux par deux et orientés les uns par rapport aux
autres. La luxuriance du décor, en mosaïques de pierres et de cônes d’argile aux têtes de couleurs variées, frappe le visiteur. Les architectes tentèrent la mise au point de techniques nouvelles
(ils utilisèrent parfois des briques de plâtre, qu’il faudrait appeler des parpaings). Ces essais en disent long sur la dynamique créatrice de l’époque.
Les critères d’une ville sont l’existence d’une architecture monumentale, de l’écriture, d’échanges à longue distance, témoins des caractères sociaux ou économiques attestant la réalité du fait
urbain : population nombreuse, artisanat spécialisé, concentration de surplus de production entre les mains d’une autorité centrale, développement d’une hiérarchisation sociale et finalement
existence d’un état se substituant peu à peu aux liens de parenté.
La ville, avant d’être une forme d’habitat spécifique, est un lieu où se tissent entre les gens des relations particulières, directement liées à l’ampleur de la population qui y habite.
Le corps social étant très vaste, des relations de voisinage s’ajoutent à celles, traditionnelles, de parenté et d’alliance (qui d’ailleurs se schématisent), et une part d’anonymat s’installe
donc entre les gens. Surtout, l’ampleur de la population entraîne sa hiérarchisation, car l’appareil qui contrôle la société doit s’adapter à la nécessité de gérer des effectifs accrus.
Une élite héréditaire s’est dégagée peu à peu de la masse, au point de constituer un groupe relativement à part, dominé par un personnage plus important que les autres, et que l’on appelle le
seigneur.
Ces élites (et les institutions qu’elles représentent) sont au cœur d’un immense mouvement de biens centripète (force attirant vers un point central), en raison de leur capacité à mobiliser de la
main-d’œuvre, selon un système qui s’apparente plus à la corvée (travail non rémunéré imposé par un maître à ses dépendants, elle est un rouage essentiel du système politico-économique et tire
son existence de l’absence de la monnaie à cette époque – inventée par Crésus au -VIè siècle, les sables aurifères de la rivière Pactole lui assurant une fortune colossale) qu’au tribut (se dit
de ce qu’on est obligé d’accorder : contribution périodique en nature qu’un état impose à un peuple vaincu comme signe de la dépendance).
Leurs ressources leurs permettent de financer des travaux d’intérêt public (comme le développement du réseau d’irrigation), de doter leur ville de monuments exceptionnels, d’entretenir leurs
dépendants, et bien sûr de subvenir à leurs propres besoins (vitaux ou futiles – mais « nécessaires » dans ce type de société – comme avec les biens de prestige).
A partir d’Uruk IV-III (vers -3 000), ainsi qu’à Suse (partie iranienne proche de la Mésopotamie), il existe
un vrai dynamisme sur le plan architectural et dans le domaine des objets de luxe. La plupart des édifices d’Uruk IV sont de vastes salles dans lesquelles ont peut pénétrer de tous côtés : ils
ressemblent plus à des bâtiments de réception ou d’audience qu’à des temples.
Tant sur les images de la glyptique (« écriture » iconographique) que sur les reliefs, une image nouvelle apparaît : celle du seigneur. Reconnaissable à son costume, il frappe par l’autorité
qu’il manifeste : il domine des scènes, il dirige des défilés, il préside à des massacres de prisonniers, il « nourrit » des animaux (allusion probable au vieux mythe de la Maîtresse ou du Maître
des animaux). Les destinées d’Uruk (l’imagerie est semblable à Suse) sont présidées par un seigneur, un « potentat » (cette dénomination s’applique lorsque les états n’avaient pas de constitution
ou de code des lois qui décrivent les institutions auxquelles sont conférées les délégations de pouvoir dans les états modernes ; la structure étatique elle-même étant embryonnaire, on parlait de
potentat). Mais il n’est nulle part engagé dans un culte, aucune figure divine ne paraît honorée.
Le sentiment de l’existence d’un monde supra-humain auquel les humains sont reliés est une forme de pensée spirituelle très ancienne. En revanche, l’attirance vers une dimension supérieure
peuplée d’êtres identifiés et organisés en une pyramide de compétences garantissant le bon fonctionnement du monde, suppose l’existence d’une structure équivalente dans la société habitée par ce
sentiment.
Dans le monde de l’Orient ancien, une telle structure cohérente voit le jour au cours des -Vè et -IVè millénaires. Cependant, malgré l’architecture, qui dénote l’apparition d’espaces liés à
l’expression d’un pouvoir dont l’échelle dépasse celle de la simple chefferie, rien ne permet d’affirmer l’existence d’une monarchie et, en miroir, d’un panthéon. La religion est étroitement
dépendante de l’organisation sociale et conçue sur le modèle de la société, elle ne sort pas des terreurs ni des seules psychologies individuelles : elle est une chose sociale !
Même si les mythes sont multiples, curieusement, quelles que soient leur origine, leurs récits évoquent
toujours les mêmes images de départ : le vide, le désordre, l’indistinct, l’inerte ! Ce qui ne signifie pas le néant : pour les Anciens, le monde que nous connaissons est vide tout en étant
quelque chose !
Qu’il s’agisse d’un abîme sans fond ou d’un océan sans limite (l’air et l’eau sont des éléments respectivement fluide et liquide qui suscitent par leur mobilité l’image d’un dieu capable
d’apporter le mouvement et donc la vie, à la matière primordiale figée dans l’immobilité), c’est de cet espace primordial que va d’abord naître la matière. Quelles que soient les traditions, le
monde naît du divin ! Le hasard, s’il existe, part d’un dieu créateur et y ramène : souvent, celui-ci jaillit d’un œuf, forme parfaite symbole de l’unité génératrice et réservoir illimité des
possibles. Le véritable commencement du monde s’identifie à l’acte qui transforme la matière primordiale en cosmos. La procédure suit trois modèles : le premier fait référence à la procréation, à
la génération sexuée ; le deuxième met l’accent sur le savoir-faire artisanal ; le troisième fait appel à la thèse du pouvoir, créateur de la parole divine.
Les dieux créateurs des premiers âges donnent tous naissance à des monstres. Les récits fondateurs n’imaginent pas d’emblée un monde parfait, mais un Univers en gestation où les premières
créatures, symboles des éléments naturels (l’eau, la terre, le feu, la sécheresse, le froid, etc.) sont des dragons immondes. Ces monstres, souvenir peut-être des gros lézards de la préhistoire
(le serpent est l’une des figures les plus fréquentes, pouvant se déplacer sur terre comme sur l’eau et grimper, logeant également sous terre, donc en rapport avec toutes les grandes forces
naturelles), se disputent et s’entredévorent sous le regard agacé de leurs géniteurs, eux-mêmes repoussants.
La vision des premiers âges est toujours violente : le choc des éléments est symbolisé par le combat des enfants des dieux créateurs. Ils se querellent tant et si bruyamment, que le père décide
de s’en débarrasser (comme les humains avec le Déluge). Mais l’un des fils le tue : le meurtre familial est l’une des constantes des mythes fondateurs, pour que puissent commencer, après le temps
des monstres, l’organisation du monde et l’âge des humains ! En tuant le père, propriétaire exclusif du harem, le fils permet aux membres de la tribu de se partager les femmes et assurer ainsi
leur descendance. Après le meurtre, acte fondateur par excellence, le père devient totem et donc tabou : nul ne peut le toucher ! Ainsi naît la loi, à travers un événement traumatique, fondateur
du mythe.
Violence sans fin ? Non, nouvelle étape. Si un fils peut supprimer un dieu créateur, c’est qu’il jouit d’une qualité nouvelle, indispensable à l’organisation du monde : l’intelligence ! Le fils
criminel est ainsi le plus « sage », et le plus « capable ». Libérés des forces brutes, les dieux « sapiens » peuvent organiser le ciel et la terre et préparer la venue de l’humain. Ces
conceptions véhiculent l’idée que le créateur et sa création partagent la même essence !
Aux origines, les dieux vivaient et étaient comme des bêtes ; avec la création de l’humain, ils se civilisent, adoptent des manières de table, se nourrissent de mets panifiés et s’abreuvent de
boissons fermentées : la création de l’humain est donc la marque de la naissance des dieux ! Cette dernière se fonde sur la division qui seule peut permettre l’établissement d’un ordre stable et
définitif à partir d’un désordre qui confine à l’informe. Le monde naît ainsi de la tension entre l’unité et la division : sa mise en ordre peut soit aboutir à l’établissement d’un pouvoir qui se
perpétue à l’aide de la violence et de la persuasion, soit elle est sans cesse remise en cause par un mouvement qui va de l’un au multiple et vice-versa. Souvent, les premières divinités naissant
du chaos sont le résultat d’une reproduction non sexuée. Par la suite, lors du premier rapport sexuel créateur d’autres divinités, une forte proximité se crée : cette étreinte est beaucoup trop
rapprochée, empêchant la venue au jour des enfants et arrêtant ainsi le processus de division en cours. Pour que ce processus reparte, il faut que le fils rompe l’union parentale par un acte
d’une extrême violence, la castration du père, qui permettra l’établissement d’une bonne distance entre dieux et déesses : le masculin et le féminin sont alors bien définis ! Mais la distance
instaurée risque de déclencher une réaction inverse (comme souvent, d’un extrême à l’autre), une séparation trop grande : lorsque le masculin et le féminin sont séparés, leur union devient en
effet problématique. Un nouveau type de proximité entre les êtres est alors établi : au sexe vécu dans la violence va ainsi succéder l’Amour né de la persuasion ! Avec la castration, la sexualité
n’est pas abolie (risquant alors d’entraîner la disparition de l’humanité), elle change d’allure ! Ce n’est plus la peur (souvent les hommes, ou les femmes, étaient échangés pour créer des
réseaux d’alliance), mais le désir qui rapproche les sexes. De surcroît, dans le jeu du désir, les deux partenaires tiendront dans la relation amoureuse un rôle qui relèvera de leur
initiative.
Pour autant, par le mariage, la femme est pour l’homme le seul moyen d’avoir des enfants et d’assurer ainsi une certaine forme d’immortalité. Mais pour nourrir sa famille, l’homme doit travailler
la terre et récolter des céréales. L’espèce humaine peut donc se perpétuer, mais à la condition d’établir entre les hommes et les femmes des relations génératrices de maux associés à la mort et
au travail. La lutte contre la mort exige que la femme souffre en enfantant, tandis que l’homme perd sa vie en travaillant. Mais une vie livrée au mal sans amnistie serait invivable.
Heureusement, l’espoir de jours meilleurs est là, parce qu’il y a le mal, alors que sans possibilité d’échapper au mal il n’y a pas d’espoir. Les humains ont ainsi foi dans la loi qui ordonne et
protège (pour ces humains d’ordre, rien ne les répugne plus que le chaos : le droit, la loi, la codification de toute démarche ont de fait valeur fondamentale), refusent l’individualisme qui
affaiblit, sont proches de la nature qu’ils révèrent autant qu’ils craignent, mais ont surtout une forte volonté d’agir sur leur destin !
Les dieux apportent alors la civilisation, débarrassent l’humain des êtres monstrueux, fauves/rapaces et
serpents, et mettent à sa disposition les animaux dont il peut se nourrir grâce à la chasse ou l’élevage, autant qu’ils enseignent la culture des végétaux.
Avec tous ces changements, on cherche un monde ouvert, à ordonner ! Et l’on commence par le plus simple : la communauté élémentaire, la famille, le clan, puis la cité. Ces entités assurent leur
identité grâce à la généalogie que racontent les récits fondateurs : sont ainsi fondés l’origine, le rattachement à un territoire, la parenté, les liens d’amitié comme les rapports de haine ! Les
sociétés polythéistes s’ordonnent et se limitent grâce aux mythes, qui les aident aussi à se problématiser. Essentiels sont les mythes de succession, qui, à travers l’ordre des dieux, nous
amènent à l’ordre du monde.
A travers les mythes s’expriment aussi ce que ne peut connaître l’expérience humaine, le royaume des morts. Avec la partition annuelle du séjour d’une divinité (souvent féminine) en Enfer, on
assiste alors à un compromis, organisant la relation entre le monde d’en-haut et celui d’en-bas, dans le souci de respecter à la fois l’intérêt des récoltes qui naissent de la terre et celui des
morts qui y sont enterrés. Le cycle végétatif (pendant l’hiver, les graines sont sous la terre, invisibles et comme mortes ; au printemps, des tiges commencent à sortir, puis les plantes se
forment et poussent avant d’être récoltées) associé à la vie humaine peut également alors faire naître l’espoir d’une survie de l’âme humaine, telle une graine (sachant que les humains vivent sur
la terre en dérobant le grain dans le sol) : la vie ne se termine pas avec la mort, elle se poursuit à travers elle !
Tel le jardinier de la vie et l’organisateur de son pré carré, on remarque l’image du seigneur, souvent plus
grand que les autres (selon une convention appelé à un long avenir). Il n’est pas symbolisé ou idéalisé, mais représenté de façon réaliste, humaine : c’est un personnage historique et non une
idée ou un concept. Le fait qu’il apparaisse en même temps que des signes écrits, qui permettront plus tard le souvenir d’évènements historiques, n’est pas le fait du hasard. En ce sens, les
représentations d’Uruk diffèrent de celles des époques antérieures. Ces nouveautés reflètent l’émergence des notables, dont on a vu l’esquisse dans la culture de Gawra, très peu éloignée dans le
temps.
A Uruk, le centre de la cité est son cœur politique. L’Eanna est une acropole où se pressent les bâtiments prestigieux dus à la volonté de l’élite de la cité, dorénavant unie autour d’un seigneur
reconnaissable. Sur cet emplacement se dressent de grandes constructions, hypertrophies des résidences d’audience de l’époque d’Obeid, plus grandes, plus ornées, plus spectaculaires, mais de même
type. On y adjoint des formes architecturales nouvelles : salles à piliers, bâtiments labyrinthiques. Ils ont été construits parce que des seigneurs étaient en mesure de mobiliser à leur profit
les ressources qui convergeaient vers eux. La hiérarchisation sociale, devenue pyramidale, a franchi un cap décisif : c’est cela finalement que désigne le mot urbanisation.
Les bâtiments de l’Eanna sont très ornés, ils sont forts accessibles (à travers de multiples entrées) : ils sont peut-être d’ordre rituel, mais d’autres sont des habitations ou des salles de
réception dans la tradition obeidienne. C’est un ensemble palatial, mais en pièces éclatées : c’est plus le Kremlin que Versailles. C’est tout l’ensemble de l’Eanna qui est le palais d’Uruk (à
l’origine, c’était un village ; sa fusion avec Kullab donna naissance à Uruk). Son maître, le seigneur, chef de la cité, garantit la prospérité du pays, la fertilité des plantes et des troupeaux,
il nourrit – ou vivifie – les troupeaux.
Au sommet d’une élite qui en dépend (autant que le seigneur a besoin d’elle), le chef de la cité est à la tête de la société, c’est-à-dire de la ville et de sa région. L’élite qui gravite autour
du seigneur se sépare de façon très marquée du reste de la population (il suffit d’observer la richesse de l’ornementation architecturale de l’Eanna). Cette élite exerce un pouvoir coercitif et
les prisonniers qui sont attaché et qui gisent devant le seigneur ne sont pas forcément des étrangers (mais peut-être les premiers Contestataires de ce nouveau pouvoir, absolu). C’est l’avènement
d’un pouvoir politique sur l’ensemble de la société et le pouvoir dispose de la force : là encore, l’urbanisation témoigne d’un bouleversement en profondeur. Uruk est ainsi le premier micro-état
!
Dans le cadre de l’artisanat spécialisé, les céramiques peintes disparaissent au profit de poteries
monochromes faites en série : ces nouvelles pièces, désormais fabriquées au tour (une des premières machine de l’humanité), marquent la disparition d’un mode d’expression reposant sur le décor
peint. Ce développement des besoins d’ordre ostentatoire, lié à la hiérarchisation de la société (pour se démarquer des autres et en imposer, afin que les autres respectent l’autorité
seigneuriale), favorise l’apparition d’artisans de haut niveau et encourage d’autant plus l’innovation que des mécanismes de mode, de surenchère, d’émulation renouvellent sans cesse la demande et
la font toujours plus exigeante. Les artisans qui produisent pour l’élite mettent prioritairement en œuvre des matériaux nobles qui, n’étant pas disponibles dans le sud mésopotamien (d’où leur
importance et leur prestige), doivent être importés de l’extérieur et souvent de régions très lointaines.
De façon à garder la maîtrise des gains et des dépenses, des techniques gestionnaires de plus en plus performantes sont mises au point : des sceaux-cylindres pour authentifier des scellements,
des jetons diversifiés pour comptabiliser les marchandises les plus variées, et surtout l’écriture pour conserver la trace d’informations plus détaillées.
Au sein de quelques agglomérations apparaît l’écriture : la naissance de cet outil est liée à des soucis de classement et de gestion. C’est la première trace d’une administration encore
embryonnaire : l’état, qui cherche à contrôler l’ensemble d’une société, en est là aux premières tentatives. L’écriture représente une révolution de l’esprit humain : il a d’abord fallu isoler la
pensée, en faire une sorte d’objet reproductible par des pictogrammes, des images aide-mémoire. Cette opération est considérable.
L’écriture permet un travail absolument inédit jusque-là sur tout ce que l’humain peut se représenter, sur
l’appréhension et la transmission des faits comme celles des idées. L’humain a maintenant sa pensée devant lui.
Au terme du processus de détachement du pictogramme de l’objet qu’il désigne, le système graphique devient une écriture de mots.
L’humain peut non seulement conserver par écrit la pensée, mais aussi consigner la parole et la langue. On ne se contente plus d’aide-mémoire : on peut informer et instruire. Par là même, une
certaine conception de la science et du divin se trouvent bouleversées.
C’est ainsi à Uruk qu’on a retrouvé les premiers documents écrits : les plus anciennes tablettes d’argile recouvertes de signes d’écriture (sur lesquelles un chiffre est suivi d’un nom de
personne, d’animal ou de denrée) ont été retrouvées à Uruk IV (vers -3 200). L’écriture est donc bien apparue en Mésopotamie du Sud, dernier stade d’une longue évolution, dans le but de
transmettre un « compte » dans le temps (pain d’argile portant l’empreinte de jeton – pour définir l’objet et sa quantité –, et des sceaux – pour identifier le propriétaire). Pour conserver la
mémoire d’opérations diverses (essentiellement économiques), on est passé d’une « écriture » en trois dimensions (jetons et leurs enveloppes), à une « écriture » en deux dimensions par impression
de signes et de sceaux sur une surface plate.
A Uruk, ces systèmes comptables de la fin du -IVè millénaire débouchèrent sur la création d’une véritable écriture. C’est seulement là que les systèmes de comptabilité ont entraîné la création de
signes qui accompagnent et précisent les chiffres. Il ne s’agit pas d’une notation figurative, encore moins d’un véritable langage écrit, mais de simples aide-mémoire (il faudra attendre des
siècles avant qu’on invente un système graphique suffisamment souple et précis pour rendre compte des nuances infinies de la langue parlée).
On se contente de comptabiliser les entrées et sorties de biens divers dans le cadre d’une gestion simple, même si elle commence à recourir aux outils écrits. Une petite partie de la population
éprouve le besoin de garder trace de quelques mouvements économiques par des signes permanents, se distinguant en cela du comportement du reste des habitants : l’élite maîtrise un outil dont la
plupart des citadins n’ont pas besoin.
La ville sumérienne est au cœur d’un réseau de relations : c’est un centre économique lié à un arrière-pays
avec lequel il entretient des relations multiples. A 900 km de là (à Habuba Kebira en Syrie, près d’Alep et de Mureybet), les Urukiens créèrent une nouvelle ville, sur les bords de l’Euphrate :
c’est un parfait exemple d’un réseau urbain mis en place par les Urukiens dès le milieu du -IVè millénaire (mais qui ne vécut que 150 ans), au bénéfice de la Mésopotamie du Sud. Les Urukiens
allaient chercher eux-mêmes les matériaux, en s’installant en Syrie du Nord sur des sites qui leur donnent accès aux gisements métallique d’Anatolie ou aux cèdres du Liban.
Le désert de Syrie est une terre aride, peuplée de nomades qui n’ont d’autres ressources, en cas de sécheresse, que de se tourner vers les terres luxuriantes. L’organisation de défenses de ce
côté du territoire est donc primordiale.
Bien que facilité par la topographie, cette tâche nécessite la levée de fortifications et la création de patrouilles sur une assez longue bande. En effet, vu la nature du danger, des razzias, il
fallait pouvoir stopper les pillards lors de leur avancée, et éventuellement les intercepter lors de leur retour.
Une telle logistique étant lourde à porter, la solution fut l’implantation de colonies, chargées, en échange de terres, de la surveillance de la frontière. Les forteresses protégeaient les
colons, les points d’eau, les routes commerciales, servaient de relais ou de villes administratives. Cette solution permettait de plus de résorber l’excédent de population résultant de la
prospérité de territoires unifiés.
Habuba Kariba était le plus grand établissement d’une série d’installations urukéennes dans la moyenne vallée de l’Euphrate. Ces établissements, à l’écart du cours majeur du fleuve pour les
protéger des crues, permettait de contrôler et d’exploiter la vallée : on y cultivait surtout les terres basses, et celles du plateau quand les pluies le permettaient. Les établissements
contrôlaient aussi la circulation des biens et des personnes le long du fleuve.
L’agglomération d’origine (environ 6 ha) occupait une étroite bande de terrain sur l’ancienne terrasse du
fleuve, entre le lit et le plateau désertique occidental. En une seconde phase, la ville s’entoura d’un rempart régulier (de 3 m d’épaisseurs et renforcé tous les 14 m par des bastions), implanté
à l’ouest de la cité (donc pour se protéger des attaques venant du désert, pas des crues ou de navigateurs arrivant par le fleuve). Il s’agissait d’un ample projet, qui nécessitait une
coordination des efforts.
La ville recouvre alors une dizaine d’hectares. Enfin, en une dernière phase, elle atteint son extension maximum (22 ha) : en 150 ans, la surface de la ville n’a cessé de croître, de manière
exponentielle puisqu’au terme de deux phase d’expansion la ville a presque quadruplé de surface. Un tel développement ne peut s’expliquer que par l’arrivée de vagues de colons successives, ce qui
souligne l’ampleur de la colonisation urukienne de la région, surtout que cette ville-là n’était pas la seule colonie ni la plus importante.
La phase 1 correspond à la fondation de la nouvelle colonie dans une région encore stable. Une fois le site fermement établi, celui-ci se développe normalement (à proximité des portes de la ville
se regroupent des ateliers). La croissance urbaine de la phase 3, faisant illusion, correspond au déclin de l’activité régionale (en crise depuis la phase 2 avec la construction du rempart),
annonçant l’abandon prochain de la ville et la fin de l’aventure coloniale urukienne. La croissance urbaine de la phase 3 avait été alimentée par le repli de la population rurale, voire même
d’une colonie voisine, sur la ville. Sûrement à la suite de graves conflits avec les locaux ne voulant pas subir ce système nouveau car citadin (et tout ce que cela implique en terme politique et
économique), le site est abandonné de manière totale et subit (mais calmement, pas déserté dans la hâte), il ne sera jamais réoccupé.
La maison type de Habuba Kebira est à la croisée de deux traditions architecturales : issue du plan tripartite obeidien, elle marque pourtant une étape importante en direction de la maison
urbaine sumérienne du -IIIè millénaire, centrée sur une cour intérieure, en adaptant l’habitat au milieu urbain. Beaucoup plus grande que les maisons obeidiennes du nord de la Mésopotamie (400 m2
et certaines atteignent 1 000 m2), elle marque le repliement de la maison sur elle-même, autour d’une cour intérieure, privée, et l’apparition d’espaces destinés à la réception de visiteurs, ce
qui implique des comportements nouveaux, plus individualistes, en un mot, plus urbains. Avec Habuba Kebira, c’est la maison de ville que l’on voit naître.
Dans la partie sud de la ville, sur une colline artificielle (tell), sont regroupés plusieurs bâtiments formant un ensemble, proche de celui d’Uruk. Une résidence tripartite, à l’est, borde une
grande cour, il est flanqué d’un magasin renfermant des rangées de grandes jarres. Le long de la cour, à l’ouest, une autre résidence, un peu plus vaste que la première, est construite sur le
même plan. Au sud de la cour se trouve un bâtiment de plan original. Enfin, au nord de cet ensemble, fut adjoint un quatrième édifice plus petit : les murs de la salle sont ornés de doubles
niches très élaborées. L’ensemble monumental présente donc trois phases de développement, qui coïncident avec celles de la ville.
Ces résidences, serrées les unes contre les autres, mis en évidence par la terrasses qui les supporte et leur permet de dominer les autres constructions, n’ont livré aucun matériel religieux. Ces
édifices respectent le plan tripartite des maisons, mais les dimensions, les niches des murs, la terrasse sont là pour témoigner du statut spécial des occupants. L’ensemble de ces bâtiments
disposés autour d’une cour correspond à la résidence du chef de la ville et aux salles nécessaires pour recevoir les chefs des grandes familles qui habitant la bourgade : les bourgeois (les
notables du bourg) se rencontrent chez leur chef.
Même si la cité est assez petite (avec environ 1 500 personnes à son apogée), elle est l’exemple le plus ancien d’une ville au sens strict du terme, car ce n’est pas le nombre de la population
qui fait la ville, mais la structure sociale des habitants !
On retrouve l’expansion de la civilisation d’Uruk, sur le long de l’Euphrate (en Syrie, au-delà de la
frontière syro-turque), jusqu’aux sources du Tigre (dans le Taurus anatolien), mais aussi dans les confins iraniens (par-delà le Zagros, en bordure du désert central).
Qu’allaient donc chercher si loin les Urukiens de la basse Mésopotamie ? Faut-il parler d’un « système-monde urukien » sur le modèle de la colonisation européenne du XIXè siècle, dans lequel des
cités sud-mésopotamiennes auraient mis à contribution, voire exploité, des chefferies locales qui n’accéderont que plus tard au stade urbain ? Les populations urbaines, socialement plus
développées, auraient-elles, en conséquence de l’urbanisation, éprouvé des besoins particuliers, par exemple en matières premières (si possible de luxe), dont des régions moins développées
n’avaient que faire ? On a relevé à Habuba Kebira des objets de nature exotique (ou étrangère) : vases d’albâtres d’un type connu à Suse, des fusaïoles (nécessaire au tissage : il servait de
poids au fuseau, permettait de maintenir la régularité de la rotation et empêchait la laine de tomber du fuseau pendant le filage) en pierre rouge originaire du Taurus, des jarres de type
levantin, des vases anatoliens, des céramiques palestiniennes et même égyptiennes (l’art égyptien prédynastique de Nagada II-III, vers -3 300/-3 100, à la veille de la fondation de la monarchie,
trahit des influences thématiques mésopotamiennes, alors que les Urukiens allaient y chercher de l’or dès -4 500). Est-ce suffisant pour faire de Habuba Kebira et des bourgades semblables des
postes commerciaux fonctionnant au bénéfice des grandes cités mésopotamiennes ? Mais sinon comment expliquer ces créations de réseaux urukiens ? Et comment rendre compte de ce qui ressemble bien
à un écroulement du système à la fin de l’Uruk récent ?
Si l’économie-monde a précédé le capitalisme, il convient de se demander comment a pu fonctionner aussi tôt
un système économique unissant plusieurs sociétés différentes, interdépendantes bien que d’un niveau de développement inégal, sur un espace d’échelle continentale. En théorie, il faut un ou
plusieurs centres moteurs exprimant loin une demande en produits non disponibles sur place, des nœuds intermédiaires pour relayer ce trafic sur d’aussi longues distances et un système d’échange
performant malgré l’absence de monnaie.
Un système d’échange souple et efficace est en place depuis bien longtemps. Il s’agit de l’échange de dons que l’on appelle plus couramment l’économie des biens de prestige. Comme elle en précède
largement la mise en place, l’économie des biens de prestige ne suffit pas pour que se forme une économie-monde précapitaliste. Celle-ci exige aussi une hiérarchie de partenaires ordonnés
spatialement. Cette forme de centralisation politique, économique et démographique, basée sur la cité, a logiquement engendré un élargissement progressif de l’aire d’acquisition, non seulement
pour la subsistance de ces concentrations humaines, mais aussi pour bien d’autres commodités plus sociales que strictement économiques : artistiques, architecturales, artisanales, etc.
Les biens de prestige avaient modifié, par leur simple présence, l’organisation politique des autres communautés, plus ou moins civilisées. Elles renforcèrent leur coordination en se
hiérarchisant afin de mieux tirer avantage de la demande : c’est une adaptation des formes locales à des conditions économiques créées par les centres urbains et intégrant un monde de plus en
plus vaste.
Certains de ces sites, créés de toutes pièces, sont de véritables colonies où des gens originaires du sud
reproduisent le mode de vie qui leur est propre, à côté de populations locales bien moins développées (mais tant mieux pour elles). Les matériaux exotiques extraits ou échangés aux confins du
réseau sont drainés vers ces centres de transit, puis convoyés vers les cités commanditaires, à travers une série de gîtes d’étape.
Si l’investissement est aussi lourd, c’est que la forme de circulation à longue distance qui avait cours jusque-là, procédant de proche en proche au gré de multiples intermédiaires, n’autorisait
ni la régularité, ni l’ampleur du flux dont les Urukiens ont « besoin ». L’ensemble du système est mis en place et entretenu (ce qui implique l’invention de la diplomatie interrégionale) par les
élites des micro-états sud-mésopotamiennes qui, seuls, ont l’autorité propre à mobiliser les énergies, les moyens d’organiser et de financer des projets d’une telle ampleur. Les notables qui
tiennent les rennes du pouvoir sont en situation de monopole, et l’acquisition de produits exotiques ne dépend en rien de particuliers qui tenteraient leur chance au loin dans l’espoir de
s’enrichir. La libre entreprise n’a pas encore été inventée, et l’on n’est pas dans une logique économique : les biens ainsi acheminés ne dégagent aucun profit, et d’ailleurs ne sont pas destinés
à gagner l’ensemble du corps social. Leur diffusion dépend entièrement de l’élite qui contrôle à la fois leur approvisionnement et les spécialistes chargés d’assurer leur retraitement, ce qui
permet d’éviter, ou au moins de retarder, l’usure des marques ostentatoires (qui tôt ou tard, sous une forme ou une autre, gagnent le grand public).
La ville effectue ce qu’elle symbolise : outils de gestion nouveaux, dynamisme expansionniste, humanisation
soudaine des représentations figurées (amenant les dieux à sa suite). En fin de période, des objets mobilisent l’image, principalement destinés à exalter le pouvoir seigneurial : le vassal, ou le
fidèle, s’en remet à la foi et aux ordres de son souverain seigneur ou dieu, où il combattra pour lui et le suivra en tout.
Au même moment, de vastes bâtiments émergent, parfois ornés de manière recherchée : l’art est devenu propagande, aux seules fins de pouvoir, non plus accessible au commun des mortels. A cette
époque apparaissent définitivement des représentations humaines « enfin » réalistes : la révolution urbaine est une révolution humaniste en ce sens que l’humain, enfin reconnaissable (alors que
la femme et son principe naturel reproducteur l’est plus ou moins depuis les Vénus préhistoriques de -35 000 environ, en Europe), s’assure dans le monde des représentations figurées la place
éminente qu’il ne quittera plus et qu’aucune figurine néolithique n’avait occupée à ce degré. Sur ce point aussi cette époque marque une rupture. L’anthropomorphisme des représentations figurées
permet l’avancée notable des conceptions religieuses. La charnière du -IVè au -IIIè millénaire est l’époque où s’élaborent les premières esquisses théologiques et où sont définies les premières
figures divines.
A l’intérieur des bâtiments résidentiels, des temples juxtaposés apparaissent également (et pour la première
fois), pour matérialiser la présence divine et fournir ainsi une référence indiscutable (grand juge qui justifie et ordonne les actes du seigneur). Seigneurs régnants ou princes écartés de la
succession, ils sont de la race des nobles, et nobles légitimes en raison de leurs qualités hors du commun. Honorés, glorifiés, riches et puissants. Ce sont ces seuls seigneurs qui sont comme des
dieux. Et s’ils sont comme des dieux, c’est aussi que les dieux sont comme des seigneurs. Eux aussi sont honorés, glorifiés, tout comme le sont les rois, puissants mais plus que les
seigneurs.
L’existence de pratiques spirituelles est attestée depuis les débuts de la sédentarisation. Mais le temple, tel qu’on le connaît en Mésopotamie à l’époque historique, n’émerge qu’à Eridu (puis
Uruk) dans le courant du -Vè millénaire. Il y eut certes des lieux de culte auparavant, mais, sous sa forme construite, le temple apparaît comme un phénomène strictement lié à la cité. Le temple
est le lieu où le dieu a choisi d’habiter et où se réalise le service que les humains lui doivent, puisque tel est le destin de l’humanité. Composé d’un podium (emplacement du trône divin), d’une
table ou autel d’offrande et d’une porte d’accès (ou vestibule) qui assure la relation entre le lieu sacré et l’extérieur profane, cette organisation ternaire implique une progression du profane
vers le sacré qui, en guidant le service du dieu, symbolise la démarche humaine vers l’absolu. Le temple est donc davantage un lieu de vie qu’un lieu d’adoration. Ainsi, même si il existe
plusieurs degrés de complexité et de mode de construction, pour partie signes d’une certaine évolution de l’importance spatiale du temple au sein même de la cité, cela ne modifie en rien le
principe de base du culte, ni les constituants fondamentaux du temple tels qu’ils étaient établis dès l’origine.
Les prêtres ne jouent qu’un rôle politique subalterne ou indirect. La séparation du palais et du temple est une règle d’or : ou bien ils sont séparés et relativement éloignés l’un de l’autre, ou
bien ils sont juxtaposés, mais jamais ils ne se mélangent ! Le pouvoir temporel s’exerçait depuis le Néolithique dans les villages, puis dans les bourgs, et n’a certainement subi aucune éclipse.
La maison tripartite, élaborée dès l’origine du Néolithique et que l’on retrouve partout dans le Proche-Orient, est la maison commune du chef et de son clan. Le principe en est simple : au
rez-de-chaussée les réserves et les communs, éventuellement les ateliers, à l’étage l’habitat et le séjour des humains.
A l’époque d’Uruk, le mode tripartite reste en usage, mais il s’agrandit considérablement et donne naissance à des ensembles de grandes dimensions auxquels s’ajoutent parfois des dépendances.
C’est seulement durant la génération des palais de l’époque amorrite (vers
-2 000 à -1 600) que la présence d’une salle du trône s’impose, après de nombreuses complexifications de l’architecture. Contrairement aux premières théories, temples et palais ont chacun pour
leur part poursuivi une route autonome dès le début et tout au long de l’histoire syro-mésopotamienne. Il n’y avait pas de confusion des pouvoirs, malgré la tentative de divinisation du
personnage royal à l’époque d’Akkad et dans les siècles qui ont suivi, mais elle montre clairement que la tentation d’une divinisation du pouvoir royal, toujours sous-jacente, était contenue dans
les premières institutions. Dans la nature sacerdotale de la royauté assyrienne, le roi, grand prêtre du dieu Assur, ne pouvait prendre la place du dieu !
Les prêtres jouaient-ils un rôle économique en gérant de grands domaines qui servaient à assurer le culte et
l’entretien du clergé ? Ce rôle était essentiel : il existait des centres administratifs liés aux temples, parfaitement organisés.
La tâche dont est investie l’humanité, selon les anciens Mésopotamiens, est de faire durer le monde. Elle s’en acquitte principalement par ses actes de dévotion, lesquels, pour être efficaces,
nécessitent un personnel stable. Celui-ci exerce sa compétence dans des temples qui sont autant de grands complexes économiques et dans lesquels les dieux demeurent en maîtres. On entendra donc
par clergé non pas les seuls agents du culte mais aussi tous les agents administratifs et domestiques.
La plus haute fonction cultuelle est détenue par un grand prêtre lorsqu’il s’agit d’une déesse, une grande prêtresse dans le cas d’un dieu. Les activités de certains membres du clergé sont
associées à la sphère du savoir et de l’écriture. Elles exigent donc, contrairement aux autres, des connaissances approfondies. La transmission du savoir est donc l’une des préoccupations de ces
sages et théologiens et l’enseignement des scribes est très largement le fait du clergé, généralement à leur domicile. Quant au statut des personnes, on retient le principe de l’hérédité des
charges, les mêmes fonctions restant fréquemment l’apanage d’une même famille pendant des générations (histoire d’apaiser les tensions : les familles dépossédées du pouvoir politique ont en
compensation le pouvoir religieux, équivalent voire éventuellement supérieur, car si on n’apprécie pas le roi, on aime toujours les dieux).
Le roi se consacre à l’accomplissement d’un certain nombre de rituels qui lui sont réservés. Il prend l’initiative de fonder les temples.
Les divinités mésopotamiennes demandent à être nourries, abreuvées, baignées, parfumées, habillées, promenées et distraites, le culte qui leur était rendu ressemblant à un service
royal.
L’époque proto-urbaine (-3 700 à -2 900) constitue un tournant majeur de l’Histoire. L’émergence de la
civilisation urbaine au -IVè millénaire s’accompagne d’une complexité croissante des liens sociaux et d’une transformation de l’exercice du pouvoir.
Ces époques du -IVè et -IIIè millénaire voient donc la mise en place des principaux fondements de l’idéologie royale orientale, où la dialectique qui s’instaure entre les mondes terrestres et
divins passe par la personnalité du souverain. Dès l’époque proto-urbaine, la royauté contient les germes de la divinisation, lesquels vont s’affirmer avec l’empire d’Akkad, puis tout au long des
deux millénaires qui suivent. Mais, si la divinisation du souverain fut acquise à certaines époques, elle ne le conduisit jamais à ce que la nature du roi ne changeât : le roi, un mortel, demeure
un intermédiaire entre deux mondes, ce que confirment à la fois les titulatures, les images et les rites.
Deux mondes bien définis, celui des dieux et celui des rois, coexistent dans la cité (pas de pouvoir religieux dominé par des prêtres ou des « rois-prêtres », encore moins de démocratie
primitive). Une attitude humaine envers les dieux prend pour modèle un rapport social entre les humains et dont les puissances surnaturelles étaient tout d’abord totalement absentes. Les dieux
sont à la fois pareils et supérieurs à nous : les divinités ont donc été imaginées comme un reflet surexalté du pouvoir politique. Ainsi, pour se les figurer, on eu recours au visage, non des
humains du commun, mais des spécimens les plus excellents et les plus accomplis pris dans la classe des tenants du pouvoir politique. Et cette conception a dû évoluer parallèlement à l’évolution
du pouvoir politique. Les héros, les seigneurs, sont « des dieux parmi les humains ». Ce ne sont ni des demi-dieux, ni des dieux qui seraient descendus parmi les humains. Ce sont des humains,
mais qui sont comme des dieux parmi les humains : ils sont incomparablement supérieurs au commun des mortels. Ce commun, ce sont tous ceux qui se battent aux côtés des héros, qui vont à pied,
tandis que les héros vont en char, et qui meurent par centaines, sans que l’on en parle, sans que l’on décline leur identité, tandis que chaque combat se centre sur le héros qui annonce
longuement ses titres de gloire avant d’affronter un adversaire à sa hauteur, un autre héros.
Bientôt les textes permettront d’entrevoir l’existence de divinités conçues elles-mêmes à l’image de l’humain (idéalisée, mais naturelle dans ses contradictions : les dieux sont autant Amour/Paix
que haine/guerre, comme les humains/animaux). Avec l’écriture et par conséquent du temps historique, c’est le temps de l’humain qui apparaît.
Ces « avancées » se feront sentir, à des degrés divers, sur l’ensemble de l’Orient. Si la plupart des traits évoqués étaient en gestation, comme toujours, dans les époques antérieures, leur
fusion assez subite fait de cette époque une étape cruciale du développement du monde oriental.
Les micro-états urukiens, par leur prospérité, par leur exubérance, représentent l’apogée de la civilisation
mésopotamienne, et servent de modèle aux cultures qu’elles côtoient.
En dépit de leurs conflits, ces micro-états étaient liés entre eux par un sens profond de leur unité culturelle, matérialisée par l’usage de l’écriture et par une langue, le sumérien.
Ainsi, il existait vers -3 000 un sceau sur lequel étaient gravés les symboles des principales villes, expression d’une ligue qui contrôlait la circulation de certains produits.
Par-delà l’appartenance à une communauté politique, les Sumériens conçurent une vision ethnocentrique du monde, nourrie par un sens marqué de leur identité (eux qui n’étaient pas « chez eux »,
entourés qu’ils étaient de Sémites) et par l’idée que le reste du monde était destiné par les dieux à ravitailler leurs cités.
Les micro-états du -IVè millénaire sont florissants, mais leur dynamisme même fini par rendre leurs intérêts antagonistes, tant dans la plaine alluviale que dans leurs réseaux lointains.
Les colons syriens sont rappelés par leurs cités-mères, soucieuse de regrouper leurs forces pour s’entre-déchirer. C’est le début d’une longue phase de conflit, marquée par le recul momentané de
l’influence sud-mésopotamienne sur les régions avoisinantes, où les particularismes locaux réapparaissent et se renforcent.
Les micro-états sémites (et non sumériens qui se font des guerres à outrance), depuis Kish au sud jusqu’aux grands sites de la Diyala à l’est, créent des forteresses pour garder la route qui leur
permet d’obtenir du cuivre du plateau iranien, et reprennent à leur compte des contacts avec la Mésopotamie du Nord.
En Syrie du Nord, comme sur le plateau iranien, l’échange suscite des mécanismes d’évolution secondaire, en ce sens que les communautés locales se regroupent et s’organisent pour tirer partie de
la demande mésopotamienne (et des autres). Dans le domaine de l’écriture naissante, les tablettes « proto-élamites » correspondent à ce même stade du processus de développement de l’écriture que
représentent, en basse Mésopotamie, les tablettes « proto-sumériennes », avec cette différence que, en Iran, les tablettes se rencontrent déjà sur l’ensemble du plateau (ce serait donc là qu’il
faudrait voir la naissance de l’écriture). En somme, le développement culturel du plateau iranien n’est ni en retard ni tributaire de celui de la basse Mésopotamie, ce serait même plutôt le
contraire (dans une certaine mesure).
Les sites périphériques qui se constituent ou s’amplifient alors servent d’intermédiaires (sur la route des métaux précieux d’Anatolie, celle du lapis-lazuli d’Afghanistan), mais peuvent à
l’occasion développer leur propre production, comme celle des vases en pierre du plateau iranien.
Celle-ci est d’abord destinée à l’exportation, mais, parce qu’elle est valorisée, et parce que les communautés impliquées dans l’échange tendent à se hiérarchiser, les mêmes objets en viennent à
être consommés localement.
Au début du -IIIè millénaire (vers -3 000), la disparition des « colonies » urukiennes le long de l’Euphrate
et du Tigre et la réorientation de la Susiane vers les hauts plateaux iraniens (plutôt que vers la Mésopotamie du Sud) ne sont en rien une crise de la ville. Au contraire, la Mésopotamie est
entrée définitivement dans le monde des cités. Les pays voisins y entreront à leur tour et à leur rythme, à commencer par la Syrie voisine. Peu à peu se met en place le monde des micro-états,
dont Uruk était la préfiguration.
En ne parlant que de l’Orient, l’époque d’Uruk, entre Préhistoire et Histoire, est une phase fondatrice dont les ébranlements se firent sentir loin.