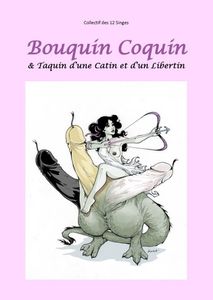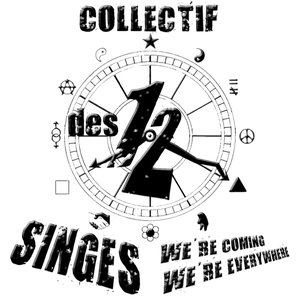Qui dit dogmes dit Contestation(s), et même Révolution(s)
!
Télécharger le fichier :
09-Les aubes des dogmes et leurs Contestations.pdf
-534/-509 : règne de Tarquin le Superbe : une Révolte le chassa. Après la mort de Romulus, fondateur du sénat romain, sept rois gouvernèrent la petite cité. Ce sont les Etrusques qui firent de
Rome une véritable ville vers -600. Tarquin l'Ancien était le cinquième des sept rois légendaires de la Rome antique, et aussi le premier roi d'origine étrusque. Il fut le premier à faire
campagne pour obtenir le pouvoir et à rechercher les suffrages de la Plèbe par des discours. Tarquin insista pour que l'élection du nouveau roi se déroule au plus vite et il manœuvra pour
éloigner les fils presque majeurs du roi Ancus Marcius dont il était le tuteur, pour se donner le champ libre. Il fut élu en -616 à l'immense majorité du Peuple pour succéder à ce dernier.
Servius (le sixième roi légendaire, et parmi eux le deuxième des rois étrusques) accéda à la royauté à la suite de l'assassinat de Tarquin l'Ancien, dont il avait épousé la fille. C'était le
premier souverain à accéder au pouvoir sans consultation populaire (-579). Tarquin le Superbe fut le dernier roi de Rome. Fils ou petit-fils de Tarquin l'Ancien, Lucius Tarquinius (le Tyrannique)
et son frère Aruns étaient mariés aux filles de Servius Tullius, ce roi pensant ainsi se prémunir contre les risques de complot dont avait été victime son prédécesseur, Tarquin l'Ancien. Or
Tullia, l'ambitieuse épouse d'Aruns, ne tarda pas à tromper son paisible mari (et au mépris de sa propre sœur) avec Lucius, son beau-frère. Ce ménage dura quelque temps, Tullia communiquant sa
folle ambition au jeune Lucius Tarquinius Superbus (en latin, l'expression « superbe » n'a pas la même signification qu'aujourd'hui, elle est a prendre au sens d'orgueilleux), puis les deux époux
encombrants disparurent opportunément. Devenus libres, les deux amants maudits purent donc s'épouser, malgré la désapprobation du père/beau-père. Poussé par sa femme, Tarquin entrepris alors de
faire reconnaître ses droits sur le trône : il chercha appui auprès des sénateurs, puis forma une escorte de jeunes gens avec laquelle il envahit le forum. Il créa du tumulte ; Servius
intervient. Pris de court, Tarquin finit par l'empoigner et par le jeter dehors où le roi fut achevé par les partisans du tyran. Tite-Live raconte que, rentrant chez elle, Tullia aurait roulé sur
le corps ensanglanté de son père.
Maître du trône par un crime (-534), c'est par des violences sans fin qu'il prétendit s'y maintenir. Il commenca par interdire qu'on ensevelisse Servius Tullius et liquida les sénateurs qui
avaient soutenu son beau-père. Il triompha des Volsques en prenant Gabies sans coup férir, grâce à une trahison de son fils, Sextus Tarquin, et Suessa Pométia. Le roi fit alors la paix avec les
Eques et renouvella le traité avec les Étrusques.
Plus tard, au siège d'Ardée, il perdit la couronne. En effet, son fils, Sextus, aussi violent que son père,
avait violé une femme de la plus haute noblesse, Lucrèce, la très vertueuse épouse d'un de ses parents, Tarquin Collatin, et celle-ci, après s'être plainte de cette injure à son mari, à son père
et à ses amis, s'était tuée sous leurs yeux.
Pour la venger, Junius Brutus, bien que parent lui-même des Tarquin, ameuta le Peuple et ôta la royauté à Tarquin le Superbe. Bientôt l'armée, qui sous les ordres du roi lui-même assiégeait la
cité d'Ardée, abandonna elle aussi ce prince, et quand il vint pour entrer dans la Ville, il en trouva les portes fermées et s'en vit exclu.
Après avoir exercé le pouvoir pendant vingt-cinq ans, il s'enfuit avec sa femme et ses enfants. Le roi et sa famille, chassés de Rome se réfugièrent en Etrurie. Tarquin le Superbe s'exila à Caeré
et fit alliance avec les Etrusques de Véiès et de Tarquinii afin de reprendre le pouvoir. Le sénat remis au Peuple les richesses de la famille royale. Le Champ de Mars (Campus Martius) occupera
l'emplacement des domaines royaux. La République déjouera, grâce à la dénonciation d'un esclave, une conspiration conduite par quelques jeunes patriciens, dont les fils de Brutus, qui visait à
restituer le pouvoir aux Tarquins. Rome remportera difficilement les affrontements qui l'opposeront aux alliés de Véiès et de Tarquinii, et instaura la république. Le régime des rois étrusques
fit prendre conscience aux Romains de la notion de corps civiques, en dehors du contrôle exclusif et très local de l'aristocratie. D'autre part les relations religieuses qui sous-tendaient la
relation client-patron s'étiolèrent, le culte des ancêtres se transformant en culte des héros. Le populus prit conscience qu'il formait la Plèbe et les institutions reconnurent son existence et
la fonction subalterne de cette Plèbe. Les Romains situaient l'avènement de la république en -509, ce qui correspond à la date de la dédicace du temple de Jupiter Capitolin. Il semble cependant
que la république a été instaurée plus tard entre -480 et -470.
Le mot république vient du latin res publica, ce qui signifie « la chose publique ». Gouverner la cité est donc une affaire publique et Collective. La devise de la république est Senatus
Populusque Romanus, le sénat et le Peuple romain. Elle symbolise l'union du sénat romain où siègent les familles patriciennes et de l'ensemble des Citoyens romains.
En effet, les Romains sont divisés en deux groupes, les patriciens et les Plébéiens. Les patriciens sont souvent propriétaires de vastes domaines cultivés. Ils appartiennent à de célèbres
familles, les gentes. Chaque gens a ses propres cultes, notamment des ancêtres, ses traditions. Elle comprend un nombre plus ou moins grand de clients qui doivent obéissance à leur « patron » et
reçoivent en échange aide et assistance en cas de besoin. Les Plébéiens forment la masse des artisans et paysans. Ils vivent en dehors de l'organisation patricienne et n'honorent aucun ancêtre
particulier. Au départ la Plèbe n'a aucun droit. Toutes les magistratures sont réservées aux patriciens
-509 : Lucius Junius Brutus et Lucius Tarquinius Collatinus, tous deux parents de Tarquin, remplacent
l'ancien roi. La république est gouvernée par deux magistrats réélus chaque année, les consuls.
-508 : Tarquin Collatin s'exile volontairement, Brutus est tué au combat. Porsenna, roi étrusque de Clusium (Chiusi) prend Rome pour rétablir Tarquin, mais renonce devant l'obstination des
Romains (exploits de Horatius Coclès, Mucius Scaevola, Clélie). Leurs successeurs sont désignés pour un an, avec le titre de praetor majus.
-494 : la Plèbe accablée de dettes et privé de tout droit, se retire en armes sur le mont Sacré.
La Plèbe naît de la sécession, lorsqu'une partie du corps civique quitte la ville de Rome, alors que la convocation par les consuls était imminente pour faire face à une guerre étrangère, et
refuse de revenir malgré les prières des patriciens. Il s'agit donc d'une Grève de la guerre.
Cette sécession est liée à une crise économique, l'historien romain Tite-Live invoquant l'esclavage pour dettes de nombreux Citoyens pauvres. C'est d'ailleurs une situation similaire qui a
provoqué les réformes de Solon en Grèce. On peut aussi évoquer une déception politique. En effet, depuis l'établissement de la république, l'exemple de la Démocratie athénienne (réforme de
Clisthène) était connu, et avait suscité des espoirs déçus par la mise en place de la république oligarchique, lésant les Droits politiques d'une partie du Peuple (au sens du populus romain,
c'est-à-dire l'ensemble des Citoyens).
Dans la Rome primitive, l'exploitation massive des esclaves n'est pas encore le fait dominant. L'opposition
fondamentale est celle des patriciens et des Plébéiens. Les premiers sont de grands propriétaires fonciers, les seconds sont de petits paysans, des artisans ou des commerçants. Les patriciens,
organisés en grandes familles, avaient le monopole des fonctions politiques et de la justice. Cependant, pour soutenir les guerres perpétuelles qu'ils livraient à leurs voisins, ils durent faire
appel aux Plébéiens. Ces derniers ne tardèrent pas à leur poser des conditions.
Tandis que la guerre avec les Volsques (ancien Peuple de l'Italie, établi au sud du Latium) était imminente, la cité était en guerre avec elle-même et en proie à une haine intestine entre
sénateurs et Plébéiens, dont la principale cause était l'esclavage pour dettes.
On s'indignait de défendre au dehors la Liberté et l'empire et d'avoir au dedans ses propres concitoyens pour tyrans et pour oppresseurs. La guerre était plus sûre que la Paix, les ennemis moins
menaçants que les compatriotes pour la Liberté de la Plèbe.
Le mécontentement se propageait déjà de lui-même quand une infortune scandaleuse fit éclater l'incendie. Un vieillard, portant les marques de toutes ses souffrances, s'élança sur le forum ; la
crasse couvrait ses vêtements ; plus hideux encore était l'aspect pâle et maigre de son corps épuisé ; en outre, la longueur de sa barbe et de ses cheveux lui donnait un air sauvage. On le
reconnaissait pourtant, tout affreux qu'il était : il avait, disait-on, commandé une centurie, et on énumérait ses brillants états de service, tout en le plaignant. Il dit que, pendant qu'il
faisait campagne contre les Sabins (peuple samnite établi au voisinage immédiat de Rome), les pillards avaient brûlé sa ferme, et qu'au milieu de ses revers, on lui avait réclamé ses impôts, et
qu'il avait emprunté. Cette dette, grossie des intérêts, lui avait fait perdre d'abord la terre de son père, et son créancier l'avait jeté, non dans l'esclavage, mais dans un cachot et dans la
chambre de torture. Et il montrait sur son dos d'horribles marques de coups toutes fraîches. À cette vue et à ces mots, des cris violents s'élèvent. L'Agitation ne se cantonne plus au forum, mais
s'étend partout dans la ville. Les insolvables, portant ou non leurs chaînes, se répandent dans toutes les rues : Pas un coin où des volontaires ne se joignent à l'Emeute ; partout, dans toutes
les rues, des bandes hurlantes courent vers le forum. On réclame, sur le ton de la menace, plutôt que de la prière, la convocation du sénat (Assemblée des chefs des familles patriciennes). On
entoure la curie (Salle du sénat) pour contrôler et régler soi-même les délibérations officielles.
Les patriciens hésitent sur la conduite à tenir. Le consul Appius voulait employer la manière forte : « Après une ou deux arrestations, tout rentrera dans le calme ».
Servilius, au contraire, voulait fléchir la Rébellion au lieu de la briser (c'était plus sûr et surtout plus facile). Là-dessus des cavaliers latins accourent, en annonçant que les Volsques sont
entrés en compagne.
À cette nouvelle, tant la nation était coupée en deux par la discorde, l'impression fut bien différente chez les patriciens et dans la Plèbe. Les Plébéiens étaient transportés de joie : « Ce
sont, disaient-ils, les dieux qui viennent punir l'orgueil des patriciens ». Ils s'exhortaient l'un l'autre à ne pas s'enrôler : « Périsse tout le monde plutôt qu'eux seuls ; que les sénateurs
prennent du service! que les sénateurs prennent les armes! que les dangers de la guerre soient pour ceux à qui elle profite! ». Cependant, le sénat, accablé supplie le consul Servilius, dont les
idées étaient plus Démocratiques, de tirer l'état des menaçants périls qui l'assiègent. Alors le consul lève la séance et se présente devant le Peuple assemblé. Il lui montre que le sénat est
préoccupé des intérêts de la Plèbe. Mais ce débat sur une classe – d'ailleurs la plus considérable – mais enfin sur une classe seulement de Citoyens, a été interrompu par un danger que court tout
l'état ; il est impossible quand l'ennemi est presque aux portes, de rien faire passer avant la guerre ; en eût-on même le loisir, ce ne serait ni honorable pour la Plèbe de se faire payer
d'abord avant de prendre les armes pour la patrie, ni très seyant au sénat de remédier à la détresse des Citoyens par crainte plutôt que par bienveillance.
Après la défaite des Aurunces (peuple d'origine osque, établi au sud-est du Latium, autour de Minturnes), les Romains comptaient sur la parole du consul et sur la bonne foi du sénat quand Appius
se mit à prononcer des sentences aussi dures que possible en matière de dettes, rendant par séries les anciens insolvables aux chaînes de leurs créanciers et en mettant même sans cesse de
nouveaux aux fers. Quand c'étaient d'anciens combattants, ils en appelaient à leur collègue. Un rassemblement se faisait devant Servilius ; ils lui rappelaient ses promesses; ils lui
représentaient leurs états de service, leurs blessures. Malgré son émotion, le consul, dans la circonstance, était obligé de se tenir sur la réserve, tant son collègue et tout le parti de la
noblesse s'étaient jetés dans l'opposition. En gardant ainsi la neutralité, il n'évita pas la rancune du Peuple, sans gagner pour cela la faveur du sénat : au sénat, il passait pour un consul
sans énergie et pour un intrigant ; dans la Plèbe, pour un fourbe, et on ne tarda pas à avoir la preuve qu'il était aussi impopulaire qu'Appius.
Alors la Plèbe, ne sachant ce qu'elle devait attendre des nouveaux consuls, tint des réunions la nuit, partie aux Esquilies (quartier populaire construit sur l'Esquilin, l'une des sept collines
de Rome), partie sur l'Aventin (l'une des sept collines, située au sud-ouest de la ville, et entièrement peuplée de plébéiens) pour éviter de prendre au forum des décisions improvisées et
confuses et de toujours marcher sans but et au hasard.
Les consuls, voyant là un danger, d'ailleurs réel, font un rapport au sénat et le sénat leur enjoint de faire les enrôlements avec la dernière énergie : « c'est l'inaction qui cause les désordres
populaires ». Les consuls lèvent la séance et montent sur leur tribunal ; ils font l'appel des jeunes gens. Pas un ne répond à l'appel de son nom ; et la foule, les enveloppant, prend l'allure
d'une assemblée pour déclarer qu'on ne se moquera pas plus longtemps de la Plèbe ; on ne trouvera plus un seul soldat si l'état ne tient pas ses engagements ; il faut rendre la Liberté à chaque
individu avant de lui donner des armes ; ils veulent combattre pour leur patrie, pour leurs Concitoyens, et non pour leurs maîtres.
Les consuls, à bout d'expédients demandent aux sénateurs les plus exaltés de se joindre à eux, et essaient d'employer la manière forte. Nouvel échec. Alors, le sénat, après une délibération
confuse, décide de confier le pouvoir à un dictateur, dont les décisions sont sans appel. Cependant, il choisit ce dictateur parmi les modérés, et la Plèbe, sur de nouvelles promesses, se laisse
encore mobiliser. Après la victoire, le sénat refuse de tenir ses engagements, et le dictateur démissionne. Alors le sénat se prit à craindre que la Libération des soldats ne fît renaître les
assemblées secrètes et les complots. Aussi, bien qu'ils eussent été enrôlés par le dictateur, comme c'étaient les consuls qui leur avaient fait prêter serment, on estima que ce serment les liait
encore, et, sous prétexte que les Éques reprenaient les hostilités, on donna l'ordre aux légions d'entrer en campagne. Cela ne fit que hâter la Révolte : l'armée cessa d'obéir aux consuls et se
retira avec la Plèbe sur le mont Sacré, sur la rive droite de l'Anio, à trois milles de Rome. Là, sans général, ils firent un camp entouré d'un fossé et d'une palissade, et, paisibles, se bornant
à prendre les vivres nécessaires, ils demeurèrent quelques jours sans attaquer ni être attaqués.
Le sénat envoie alors à la Plèbe Menenius Agrippa, consul romain issu de la Plèbe en -503, sur le mont Sacré (ou sur le mont Aventin) où s'était réfugiée la Plèbe. Ayant le devoir de réaliser la
concordance et prêchant la Coopération entre patriciens et Plébéiens, il employa le fameux apologue : « Les membres et l'estomac » grâce auquel il tenta de montrer que la cité ne pouvait exister
sans la Plèbe, mais que, parallèlement la Plèbe ne pouvait vivre sans la cité.
En fait, la Plèbe ne consent à rentrer à Rome qu'après avoir reçu des garanties concrètes : on se mit alors à traiter de la réconciliation et l'on consentit à accorder à la Plèbe des magistrats
spéciaux et inviolables, chargés de prendre sa défense contre les consuls, et à exclure tout patricien de cette fonction. Aggripa est resté célèbre pour son apologue (plus tard repris par La
Fontaine). Les dettes sont effacées.
Après s'être donné des institutions et avoir prêté serment, la nouvelle entité politique réintègre la cité.
Cette Révolution permanente légalisée parvient à équilibrer les institutions oligarchiques de Rome, au cours d'un siècle de Luttes, entre la pression quotidienne de l'intercessio tribunicienne et
la menace de la sécession, de la Grève de la guerre et de la défense de la cité, lorsque la Plèbe se retire sur l'Aventin. . Au cours du -Vè siècle, les Plébéiens obtiennent la création de dix
tribuns de la Plèbe, chargés de défendre leurs intérêts. Ils peuvent s'opposer à n'importe quelle loi proposée par les autres magistrats. C'est l'intercessio. Peu à peu la Plèbe obtient l'accès à
toutes les magistratures. Cependant la plupart des magistrats sont toujours des patriciens.
-486 : vote de la première loi agraire. Les consuls suivants furent Spurius Cassius et Proculus Verginius. On
conclut avec les Herniques un traité qui leur enleva les deux tiers de leur territoire. Cassius se proposait d'en donner la moitié aux Latins, et l'autre moitié au Peuple. Un grand nombre de
patriciens étaient alarmés du danger qui menaçait leurs intérêts et leurs propres possessions; mais le sénat tout entier tremblait pour la république, en voyant un consul se ménager, par ses
largesses, un crédit dangereux pour la Liberté. Ce fut alors, pour la première fois, que fut promulguée la loi agraire, qui, depuis cette époque, n'a jamais été mise en question sans exciter de
violentes commotions. L'autre consul s'opposait au partage, soutenu par les sénateurs, et n'ayant pas même à lutter contre tout le Peuple, dont une partie commençait à se dégoûter d'un présent
qu'on enlevait aux Citoyens pour le leur faire partager avec les alliés.
-473/-472 : À la Paix extérieure succèdent immédiatement les discordes civiles : la loi agraire était toujours l'aiguillon dont les tribuns stimulaient la fureur du Peuple. Les plus effrayés
étaient les tribuns, qui apprennent, par la mort de leur collègue Gnaeus Génucius, à quel point les Lois Sacrées sont pour eux un faible secours. On disait hautement qu'il n'y avait que la
violence qui pût dompter la puissance tribunitienne.
-472/-471 : Aussitôt après cette victoire de l'aristocratie, paraît l'édit qui ordonne les enrôlements militaires. Les tribuns épouvantés ne font aucune opposition, et les consuls procèdent
librement à la levée des troupes. Le Peuple alors s'irrite plus encore du silence des tribuns que de la rigueur des consuls : « C'en était fait de leur liberté; on en revenait à l'ancien état de
choses : avec Génucius était morte et descendue dans le tombeau la puissance tribunitienne : il fallait recourir, aviser à d'autres moyens de résister aux patriciens ; la seule ressource qui
restât au Peuple, puisqu'il n'avait plus aucun appui, c'était de se défendre lui-même ».
Tandis qu'ils s'animent ainsi l'un l'autre, un licteur vient, par ordre des consuls, saisir Publilius Voléron, homme du Peuple, qui, ayant été centurion, refusait de servir comme soldat. Voléron
en appelle aux tribuns et aucun d'eux ne venant à son secours, les consuls ordonnent qu'on le dépouille de ses vêtements, et qu'on prépare les verges : « J'en appelle au Peuple, s'écrie Voléron,
puisque les tribuns aiment mieux voir un Citoyen romain frappé de verges sous leurs yeux, que de s'exposer à être égorgés par vous dans leur lit ».
Ainsi excitée, la foule se prépare comme pour un combat : la crise était menaçante. Les consuls, qui voulurent résister à cette violente tempête, éprouvèrent bientôt que la majesté du pouvoir est
un appui peu sûr sans la force.
Contre l'opinion générale qui s'attendait à le voir user de la puissance tribunitienne pour inquiéter les consuls de l'année précédente, Voléron, sacrifiant à l'intérêt général ses ressentiments
personnels, propose au Peuple un projet de loi pour qu'à l'avenir les magistrats Plébéiens fussent élus dans les comices par tribus. Elle n'était pas sans importance, cette loi qui, à première
vue, se présentait sous un titre peu alarmant : en réalité, elle enlevait aux patriciens la possibilité d'appeler au tribunat, par les suffrages de leurs clients, les hommes qu'ils avaient
choisis. Cette proposition, si agréable au Peuple, les patriciens la combattirent de toutes leurs forces. Voléron fut renommé tribun. Le sénat, voyant que cette affaire se terminerait par un
combat à outrance, créa consul Appius Claudius, fils d'Appius, qui, depuis les démêlés de son père, était odieux et hostile au Peuple. Les patriciens ont créé, non pas un consul, mais un bourreau
pour tourmenter et torturer le Peuple. Le sénat lui adjoignit pour collègue Titus Quinctius.
Dès le commencement de cette année, on ne s'occupa que de la loi. Quinctius eut beaucoup de peine à calmer le Peuple ; les patriciens en eurent plus encore à calmer l'autre consul. D'abord la
crainte et la colère firent émettre tour à tour des avis très différents; mais à mesure que le temps s'écoule, et que l'emportement fait place à la réflexion, tous les esprits renoncent à l'idée
d'une lutte violente, et l'on en vint à rendre des actions de grâce à Quinctius, pour avoir, par ses soins, apaisé les discordes civiles.
Tandis que les consuls et les tribuns tirent chacun de leur côté, le corps de l'état reste sans force : on s'arrache la république; on la déchire; chaque parti songe moins à la conserver intacte
qu'à décider entre quelles mains elle restera. Finalement, la loi passe sans opposition : les patriciens concèdent enfin à la Plèbe le droit d´élire ses magistrats avec l'établissement de quatre
représentants (deux tribuns de la Plèbe et deux édiles Plébéiens).
-467 : Efforts du consul Fabius pour calmer le mécontentement de la Plèbe.
Après la prise d'Antium, Titus Aemilius et Quintus Fabius sont faits consuls. Déjà, dans un premier consulat, Aemilius avait proposé de distribuer des terres au Peuple. Aussi, lors de son second
consulat, on vit se ranimer l'espérance des partisans de la loi agraire : les tribuns, certains de l'emporter, puisque cette fois le consul est pour eux, renouvellent des tentatives qui si
souvent avaient échoué devant l'opposition des consuls. Les possesseurs des terres et la majorité des patriciens se plaignirent qu'un chef de l'état s'associât aux poursuites tribunitiennes, et
achetât la popularité par des largesses prodiguées aux dépens d'autrui ; ils détournèrent sur le consul tout l'odieux que ces menées avaient excité contre les tribuns.
Un conflit terrible allait éclater, si Fabius, par un expédient qui ne blessait aucun des deux partis, n'eût terminé la querelle. L'année précédente, sous la conduite et les auspices de Titus
Quinctius, on avait enlevé aux Volsques une portion de leur territoire : Antium, ville voisine, favorablement située sur le bord de la mer, pouvait recevoir une colonie : il était donc facile de
donner des terres au Peuple, sans exciter les cris des propriétaires, sans troubler la Paix de Rome. L'avis de Fabius est adopté. On invite ceux qui veulent des terres à donner leurs noms. Mais,
dès lors (comme toujours), l'abondance fit naître le dégoût, et si peu se firent inscrire qu'on fut obligé de leur adjoindre des Volsques pour compléter la colonie. Les autres, en grand nombre,
aimèrent mieux solliciter des terres à Rome que d'en obtenir ailleurs.
-462 : le tribun de la Plèbe Terentilius demande la mise par écrit des droits des consuls, pour limiter leur arbitraire. Ce projet est repoussé par les patriciens, ce qui engendre dix ans de
crise civile à Rome.
Les succès militaires ramenèrent bientôt les troubles intérieurs. Gaius Terentilius Harsa, cette année tribun du Peuple, persuadé, en l'absence des consuls, que le champ était ouvert aux
entreprises du tribunat, déclame plusieurs jours contre l'orgueil des patriciens, et attaque surtout l'autorité consulaire comme excessive, comme intolérable dans un état Libre. « Le nom en était
moins odieux, le pouvoir plus révoltant peut-être que celui des rois. Ce sont deux maîtres au lieu d'un, avec une puissance sans contrôle et sans bornes. Indépendants et déréglés eux-mêmes, ils
font peser sur le Peuple toute la crainte des lois et des supplices ». Les patriciens tremblent que l'absence des consuls n'aide à leur imposer ce joug, et le préfet de Rome, Quintus Fabius,
convoque le sénat. « Mais vous, s'écrie-t-il, tribuns mes collègues, nous vous prions de vous rappeler avant tout que c'est pour la protection du Citoyen, et non pour la perte de l'état que cette
puissance vous fut accordée, qu'on vous créa les tribuns du Peuple et non les ennemis du sénat ».
L'an d'après, la loi Terentilia, présentée par tout le collège des tribuns, attaqua les nouveaux consuls. Les livres de la Sibylle (grande « prêtresse », souvent hermaphrodite, à laquelle on
attribuait des pouvoirs de médium, entre autres à cause de ses « particularités » anatomiques, considérées alors comme une intervention divine ; chargée par les dieux de transmettre leurs Oracles
aux humains et en particulier aux puissants, elle le faisait dans un langage énigmatique permettant de nombreuses interprétations, ce qui la mettait à l'abri de toute contestation ultérieure),
consultés par les duumvirs sacrés, répondirent qu'on était menacé d'une nuée d'étrangers, qui s'empareraient des hauteurs de la ville, pour y répandre le carnage; ils recommandaient surtout de
s'abstenir des dissensions civiles. C'était fait à dessein pour entraver la loi, disaient les récriminations des tribuns : un conflit violent se préparait.
Jamais aucun des jeunes patriciens aristocrates, soit en public, soit en particulier, ne se montrait farouche sauf lorsqu'on arrivait à traiter de la loi. Autrement, cette jeunesse était
populaire. Peu à peu, ces caresses, ces attentions avaient adouci le Peuple. Grâce à ces moyens, on éluda toute l'année l'adoption de la loi.
-460 : Prise du Capitole par l'armée des esclaves et des bannis et nouvelles tentatives des tribuns pour saper l'autorité des consuls et du sénat.
Présenter la loi, la repousser; voilà ce qui occupait les esprits. Plus la jeunesse patricienne s'insinuait auprès du Peuple, plus, à leur tour, les tribuns, par leurs accusations, cherchaient à
la rendre suspecte : « on tramait une conspiration ; c'est la mort des tribuns, le massacre du Peuple qu'on médite. Les vieux patriciens ont chargé les jeunes d'extirper de la république la
puissance tribunitienne, et de rendre à l'état la forme qu'il avait avant qu'on se retirât sur le Mont-Sacré ».
Rome cependant craignait que les Volsques et les Èques ne reprissent des hostilités, pour ainsi dire périodiques, et dont chaque année amenait régulièrement le retour. Mais, plus pressant, un
nouveau danger surgit tout à coup. Des exilés et des esclaves, au nombre d'environ deux mille cinq cents, le Sabin Appius Herdonius à leur tête, s'emparent, la nuit, du Capitole et de la
citadelle. Quelques-uns, au milieu du trouble, entraînés par l'effroi, volent au forum : « Au armes ! » et « L'ennemi est dans la ville ! ». Les consuls redoutent et d'armer le Peuple, et de le
laisser sans armes. Ignorant quel fléau soudain, étranger ou domestique, produit du ressentiment populaire ou de la perfidie des esclaves, s'est jeté sur la ville, ils veulent calmer le trouble,
et, souvent, ne parviennent qu'à l'exciter. Sur cette multitude tremblante et consternée, l'autorité n'avait plus d'emprise. Cependant on distribue des armes, mais avec réserve, assez seulement,
comme on ignore quel est l'ennemi, pour former un corps de troupes qui suffise à tout événement. Le jour enfin dévoila quelle était cette guerre, quel en était le chef. C'étaient les esclaves,
qu'Appius Herdonius appelait à la Liberté du haut du Capitole : « il avait pris en main la cause du malheur ; il voulait ramener dans leur patrie ceux que l'injustice en avait exilés, et détruire
le joug pesant de l'esclavage ».
Mille sujets divers excitaient les alarmes, les esclaves surtout. Chacun pouvait avoir son ennemi chez soi. Se fier à lui, s'en méfier, au risque de provoquer sa vengeance, était également
dangereux. À peine, avec de la concorde, semblait-il possible de sauver la république.
Néanmoins, dans ce redoublement, dans ce déluge de maux, personne ne songeait à l'animosité des tribuns et du Peuple ; ce mal peu dangereux n'en était un qu'en l'absence de tout autre, et, dans
ce moment, la peur de l'étranger devait le faire cesser. Et cependant ce fut presque le seul danger réel dans cette crise malheureuse. Tel était le délire des tribuns, qu'à les entendre ce
n'était pas la guerre, mais un vain simulacre de guerre, et que cette invasion du Capitole n'était imaginée que pour détourner de la loi l'attention des esprits. Ils font donc quitter les armes
au Peuple, et l'appellent à l'assemblée pour y voter la loi. Les consuls, de leur côté, convoquent le sénat, plus alarmés des craintes nouvelles qu'inspirent les tribuns, qu'ils ne l'avaient été
de la surprise de la nuit.
Le spectacle d'une Révolte dans Rome se préparait pour les ennemis. Cependant la loi ne put passer, ni le consul marcher au Capitole. Les tribuns reculèrent devant la peur des armes consulaires.
Délivrés des auteurs de la sédition, les patriciens se mêlent au Peuple, s'avancent au milieu des groupes, et y sèment des paroles adaptées à la circonstance. Là, Publius Valérius, tandis que son
collègue veillait à la garde des portes, formait déjà ses bataillons. Il avait promis « qu'après la délivrance du Capitole et le retour de la Paix dans Rome, si le Peuple consentait à l'écouter,
il lui dévoilerait la fourberie dont la loi des tribuns devait assurer le triomphe, et qu'ensuite, plein du souvenir de ses ancêtres, de leur part d'obligation, en quelque sorte héréditaire, de
protéger les intérêts populaires, il n'apporterait plus aucun obstacle à l'assemblée du Peuple ». Sous ses ordres et malgré les réclamations des tribuns, les bataillons se mettent à gravir la
pente du Capitole.
Une foule d'exilés souillèrent le temple de leur sang, beaucoup furent pris en vie. Herdonius fut tué. Ainsi fut recouvré le Capitole. Les prisonniers, selon qu'ils étaient Libres ou esclaves,
subirent chacun le supplice réservé à leur condition.
La Paix une fois rétablie, les tribuns pressent le sénat d'accomplir la promesse de Publius Valérius et laisse présenter la loi. Le consul proteste qu'avant d'avoir remplacé son collègue, il ne
permettra point la présentation de la loi. Au mois de décembre, grâce à tous les efforts des patriciens, on nomma consul Lucius Quinctius Cincinnatus, père de Céson, qui dut entrer en charge
aussitôt. Le Peuple était consterné : il se voyait aux mains d'un consul irrité, tout puissant par la faveur du sénat, par son mérite et par l'influence de ses trois fils, mais qui, par leur
prudence et leur modération quand les circonstances l'exigeaient, lui étaient supérieurs.
Dès qu'il fut revêtu de sa magistrature, assidu à son tribunal, il y déploya une égale énergie pour contenir le Peuple et réprimander les patriciens : « c'était, disait-il, par la faiblesse de
cet ordre, que les tribuns se perpétuant dans leurs charges, régnaient non sur la république du Peuple romain, mais comme sur une famille en désordre, par la langue et les invectives. À l'avenir,
continuer les magistrats dans leurs charges, réélire les mêmes tribuns serait, au jugement du sénat, une atteinte à la république ». Les consuls se conformèrent à ces décrets ; mais les tribuns,
malgré les réclamations des consuls, furent réélus. Les patriciens, à leur tour, pour ne rien céder au peuple, portaient de nouveau Quinctius. Jamais, de toute l'année, il n'y eut sortie plus
véhémente de la part du consul : « Faut-il s'étonner, pères conscrits, du discrédit de votre autorité auprès du Peuple ? C'est vous-mêmes qui la ruinez. Ainsi, parce que le Peuple viole vos
décrets en continuant ses magistrats, vous allez les violer vous-mêmes, pour égaler en dérèglements cette multitude ».
-459 : Quintus Fabius et Lucius Cornélius ne furent pas plutôt en charge, qu'avec l'année commencèrent les
troubles. Les tribuns aigrissaient le Peuple. Une nouvelle guerre terminée, celle que les tribuns font dans Rome vient agiter le sénat.
L'autorité consulaire allait succomber sous les efforts des tribuns, lorsque survinrent de nouvelles terreurs. La crainte du péril décida les tribuns à permettre l'enrôlement, non, toutefois,
sans une condition. Comme pendant cinq ans on avait pu éluder leurs efforts, et qu'ils avaient peu profité à la cause populaire, ils demandent qu'à l'avenir, il soit créé dix tribuns du Peuple.
La nécessité arracha aux patriciens leur consentement, seulement ils spécifièrent qu'on ne pourrait réélire les mêmes tribuns. Mais afin d'empêcher qu'après la guerre, cette clause, comme tant
d'autres, ne demeurât sans effet, les comices, se réunirent sur-le-champ pour l'élection des tribuns. Trente-six ans après la création des premiers tribuns on porta leur nombre à dix, deux de
chaque classe, et on prit des mesures pour qu'il en fût de même à l'avenir.
-454 : Recherche d'un compromis entre patriciens et Plébéiens : une délégation part consulter les lois d'Athènes.
Les mêmes tribuns du Peuple, réélus l'année suivante, sous le consulat de Titus Romilius et Gaius Véturius, ne cessaient de prôner leur loi dans toutes leurs assemblées. Au moment où toute leur
activité se concentrait sur cette affaire, des courriers arrivent tremblants de Tusculum, et annoncent que les Èques sont sur leurs terres. On eût éprouvé quelque honte, après les services
récents qu'avait rendus ce peuple, à différer le secours. Plus de sept mille ennemis y restèrent, les autres prirent la fuite. Le butin fut immense. Mais, pour réparer l'épuisement du trésor, les
consuls firent tout vendre. Cette mesure excita néanmoins le mécontentement de l'armée, et fournit aux tribuns des motifs pour noircir les consuls auprès du Peuple.
Aussi, dès qu'ils sortirent de charge, et sous le consulat de Spurius Tarpéius et d'Aulus Aternius, ils furent cités à comparaître : Romilius par Gaius Claudius Cicéron, tribun du Peuple ;
Véturius par Lucius Aliénus, édile Plébéien. L'un et l'autre, à la grande indignation des patriciens, furent condamnés. L'échec qu'éprouvèrent ces consuls ne rendit point leurs successeurs plus
traitables : « on pouvait bien, disaient-ils, les condamner, mais le Peuple et les tribuns ne sauraient faire passer leur loi ». Renonçant alors à une loi qui avait vieilli depuis qu'on l'avait
présentée, les tribuns traitèrent les patriciens avec plus de douceur. Ils les priaient de « mettre un terme à leurs dissensions : si les lois plébéiennes leur déplaisaient si fort, ils n'avaient
qu'à autoriser la création, en commun, de commissaires choisis parmi le Peuple et parmi les patriciens, pour rédiger des règlements dans l'intérêt des deux ordres, et assurer à tous une Egale
Liberté ». Les patriciens étaient loin de rejeter ces offres; mais « nul, disaient-ils, n'était appelé à donner des lois, s'il ne sortait de l'ordre des patriciens ». Ainsi, d'accord sur le
besoin de nouvelles lois, on n'était divisé que sur le choix du législateur. On envoya donc à Athènes Spurius Postumius Albus, Aulus Manlius, Publius Sulpicius Camérinus, avec l'ordre de copier
les célèbres lois de Solon, et de prendre connaissance des institutions des autres états de la Grèce, de leurs mœurs et de leurs Droits.
-452 : Fondation du premier décemvirat.
Cette année se passa encore sans guerres étrangères, mais, à l'intérieur, des troubles s'élevèrent. Déjà les envoyés étaient de retour avec les institutions d'Athènes. Les tribuns n'en
apportaient que plus d'instance à demander qu'on se mit enfin à rédiger les lois. On convint de créer des décemvirs avec une autorité sans appel, et, pour cette année, de n'élire aucun autre
magistrat. Devait-on en choisir quelques-uns dans l'ordre des Plébéiens ? On agita longtemps cette question. Enfin on céda aux patriciens, à condition seulement que la loi Icilia, au sujet du
mont Aventin, et les autres lois sacrées, ne sauraient être abrogées.
-451 : Entrée en charge des décemvirs : les tribuns de la Plèbe obtiennent enfin que les lois soient écrites
et connues de tous. Dix anciens consuls, les Decemviri, investis du pouvoir absolu, rédigent la Loi des Douze Tables publiée sur le forum. Elle établit l'Egalité devant la loi entre patriciens et
Plébéiens, mais interdit les mariages mixtes.
L'an trois cent deux de la fondation de Rome, la forme de la constitution se trouve de nouveau changée, et l'autorité passe des consuls aux décemvirs, comme auparavant elle avait passé des rois
aux consuls. Le plus influent d'entre eux tous était Appius, que soutenait la faveur populaire. Il avait si complètement revêtu un nouveau caractère, que, de cruel et implacable persécuteur du
Peuple, il en était devenu tout à coup le courtisan, et captait ses moindres faveurs.
Tous les dix jours chaque décemvir rendait au peuple la justice. Tandis que cette justice, « incorruptible comme celle des dieux », se rendait également aux grands et aux petits, les décemvirs ne
négligeaient pas la rédaction des lois. Pour satisfaire une attente qui tenait toute la nation en suspens, ils les présentèrent enfin sur dix tables, et convoquèrent l'assemblée du Peuple. Pour
le bonheur, pour la gloire, pour la prospérité de la république, pour la félicité des Citoyens et celle de leurs enfants, ils les engageaient à s'y rendre et à lire les lois qu'on leur proposait.
Ils avaient établi entre les droits de tous, grands et petits, une exacte balance (mais on pouvait attendre davantage du concours de tous les esprits et de leurs observations réunies). Ils
devaient en particulier, et dans leur sagesse, peser chaque chose, la discuter ensuite, et déclarer sur chaque point ce qu'il y avait d'additions ou de suppressions à faire. Ainsi, le Peuple
romain aurait des lois qu'il pourrait se flatter non seulement d'avoir approuvées, mais encore d'avoir proposées lui-même.
Après que chacun des chapitres présentés eut subi les corrections indiquées par l'opinion générale, et jugées nécessaires, les comices par centuries adoptent les lois des dix tables. Dans cet
amas énorme de lois entassées les unes sur les autres, elles sont le principe du droit public et privé. Le bruit se répandit alors qu'il existait encore deux tables, dont la réunion aux autres
compléterait en quelque sorte le corps du droit romain. Cette attente, à l'approche des comices, fit désirer qu'on créât de nouveau des décemvirs. Le Peuple lui-même, outre que le nom de consul
ne lui était pas moins odieux que celui de roi, ne regrettait pas l'assistance tribunitienne.
-450 : Création du deuxième décemvirat.
Lorsqu'on eut indiqué le troisième jour de marché pour la réunion des comices qui devaient élire les décemvirs, les premiers personnages eux-mêmes (dans la crainte, sans doute, que la possession
d'une si grande autorité, s'ils laissaient le champ libre, ne tombât en des mains qui en seraient peu dignes) se mirent sur les rangs, et cette charge, qu'ils avaient repoussée de toutes leurs
forces, ils la demandaient en suppliant à ce même Peuple contre lequel ils s'étaient élevés. Appius se sentit aiguillonné et se faisait valoir auprès du Peuple. Ce fut au point que ses collègues
eux-mêmes, tout entiers à lui jusqu'à ce moment, ouvrirent enfin les yeux, et se demandèrent ce qu'il prétendait. N'osant encore s'opposer ouvertement à son ambition, ils entreprennent d'en
paralyser les efforts, en feignant de les seconder. D'un commun accord, ils lui assignent la présidence des comices, sous prétexte qu'il était le plus jeune. Cet artifice avait pour but de
l'empêcher de se nommer lui-même, ce dont personne, à l'exception des tribuns du Peuple, n'avait jamais donné le détestable exemple.
Mais lui, après avoir invoqué le bien de l'état, se chargea de tenir les comices, et sut tirer parti de l'obstacle Il fait élire au décemvirat des hommes qui étaient bien loin de les égaler en
illustration. Lui-même se nomme le premier, et encourt par ce fait des reproches d'autant plus amers qu'on croyait cette audace impossible. Dès ce moment Appius jeta le masque : il s'abandonna
bientôt à son caractère, et réussit à façonner ses nouveaux collègues à ses manières avant même qu'ils fussent entrés en charge. Chaque jour ils se rassemblaient sans témoins. Après avoir arrêté
de concert les plans ambitieux que chacun préparait en secret, ils cessèrent de déguiser leur orgueil, en se montrant difficiles à aborder, répondant à peine.
Dès le début, le premier jour de leur magistrature se signala par un appareil de terreur. Les premiers décemvirs avaient établi qu'un seul aurait les douze faisceaux (de licteur : instrument de
punition – verges de bois –, à l'origine du mot fascisme), et cette marque de souveraineté royale passait à tour de rôle à chacun d'entre eux. Ceux-ci parurent tous ensemble, précédés chacun de
douze faisceaux. Qu'une voix favorable à la Liberté vînt à s'élever dans le sénat ou devant le Peuple, aussitôt les verges et les haches (le faisceau de licteur et la hache sont le symbole de la
Révolution française de 1789, toujours en cours dans notre république) la réduiraient au silence et rendraient les autres muettes d'effroi. En effet, outre qu'on ne pouvait recourir au Peuple,
l'autorité des décemvirs était sans appel : ils étaient en cela différents de leurs prédécesseurs, qui avaient souffert que par ce moyen on modifiât leurs jugements, mais qui avaient tout de même
renvoyé devant le Peuple certaines affaires qui semblaient être de leur ressort. Pendant un certain temps une égale terreur régna sur toutes les classes, mais peu à peu elle s'appesantit tout
entière sur les Plébéiens. On ménageait les patriciens et ce fut au bas Peuple que s'attaquèrent le caprice et la cruauté. Un bruit s'était même répandu que leur conspiration ne limitait pas au
temps actuel l'asservissement de la république, mais qu'un accord clandestin les avait entre eux engagés par serment à ne point réunir les comices, et à perpétuer leur décemvirat pour conserver
le pouvoir qu'ils avaient dans les mains.
Le Peuple alors jette autour de lui ses regards : il les porte sur les patriciens, épiant un souffle de Liberté du côté d'où naguère ses soupçons n'attendaient que la servitude, soupçons qui ont
amené la république à cet état de malheur. Les chefs du sénat détestaient les décemvirs, détestaient le Peuple. S'ils désapprouvaient ce qui se passait, c'était avec la pensée que ces violences
avaient été méritées. Ils refusaient leur secours à des humains que leur avidité pour la Liberté avait plongés dans l'esclavage, et voulaient laisser les griefs s'accumuler pour que le dégoût du
présent fît du retour des consuls et de l'ancien état de choses un objet de désir. Ce qui seul inquiétait le Peuple, c'était de savoir comment la puissance tribunitienne, boulevard de la Liberté,
et dont il avait interrompu l'existence, pourrait se rétablir.
-449 : Menaces extérieures; les décemvirs convoquent le sénat. Les Decemviri qui se maintenaient illégalement au pouvoir sont chassés par une Révolte de l'armée et une menace de sécession de la
Plèbe. Les praetores prennent le titre de consuls. Par la loi Horatia Valeria, les tribuns de la Plèbe deviennent sacrés, leurs plébiscites ont force de loi et ils peuvent faire appel auprès du
Peuple (provocatio).
On n'avait substitué aux décemvirs aucun autre magistrat : quoique rendus à la vie privée, ils se montrèrent en public sans rien diminuer de leur arrogance dans l'exercice du pouvoir, rien de
l'appareil qui entourait leur dignité. La tyrannie n'était plus douteuse. On pleurait la Liberté perdue sans retour. Les Romains n'étaient pas seuls à douter de leur courage : déjà ils devenaient
un objet de mépris pour les nations voisines, honteuses de reconnaître un empire là où n'était point la Liberté.
Vaincus par la peur, les décemvirs se décident à consulter le sénat sur deux guerres qui les pressent à la fois. Ils font sommer les sénateurs de se rendre à l'assemblée, n'ignorant point quels
orages de haine allaient fondre sur eux : la désolation des campagnes, la cause des périls dont Rome était menacée, leur seraient sans nul doute imputées.
Lorsqu'on entendit, au forum, la voix du crieur qui convoquait les sénateurs à se réunir auprès des décemvirs, ce fut comme un événement nouveau, car on avait, depuis longtemps, négligé la
coutume de prendre l'avis du sénat : le Peuple en fut dans l'étonnement. C'était aux ennemis et à la guerre qu'il fallait rendre grâces, si l'on observait encore quelque forme de Liberté. On
parcourt des yeux toutes les parties du forum pour y chercher les sénateurs ; mais à peine en peut-on découvrir un. De là on se porte à la salle du sénat, on y observe la solitude qui règne
autour des décemvirs. Ceux-ci comprirent alors combien la haine de leur pouvoir était générale, et le Peuple vit bien, dans l'absence des sénateurs, leur refus de reconnaître à des particuliers
le droit de convoquer le sénat : c'était le commencement d'un retour à la Liberté.
À peine voyait-on un sénateur dans le forum, fort peu se trouvaient à la ville. Dégoûtés de l'état des choses, ils s'étaient retirés dans leurs terres, occupés de leurs intérêts particuliers, à
défaut des intérêts publics, et persuadés qu'ils seraient d'autant plus à l'abri des vexations, qu'ils s'éloigneraient davantage de la société et de la présence de leurs farouches oppresseurs.
Les décemvirs aimaient mieux qu'il en fût ainsi que de savoir les sénateurs présents et Rebelles à leur autorité. Ils ordonnent de les mander tous, et fixent l'assemblée au lendemain. Elle fut
plus nombreuse encore qu'ils ne l'avaient espéré : le Peuple en conclut que les patriciens trahissaient la cause de la Liberté, puisque le sénat reconnaissait le droit de convocation à des hommes
dont la charge était expirée, et que la violence seule élevait au-dessus des simples Citoyens. Ce que personne n'avait supporté d'un roi, ou du fils d'un roi, qui donc le supporterait chez tant
de simples Citoyens ? Il ne tenait qu'à eux d'éprouver combien la douleur, combattant pour la Liberté, est plus énergique que la cupidité luttant pour une injuste domination. On proposait de
délibérer sur la guerre contre les Sabins, comme si le Peuple romain avait quelque ennemi plus redoutable que ceux qui, créés pour faire des lois, n'avaient laissé subsister dans l'état aucune
ombre de légalité ; par qui, comices, magistrats annuels, succession dans l'autorité, uniques gages d'une Egale Liberté, tout avait été renversé ; qui enfin, simples particuliers, conservaient
les faisceaux et une autorité royale ! Les rois, une fois expulsés, on avait créé des magistratures patriciennes ; puis, après la retraite du Peuple, des magistratures plébéiennes. C'était trop
compter sur la terreur qu'ils inspiraient : les maux qu'on endurait semblaient enfin plus cruels que ceux qu'on pouvait avoir à craindre.
Les consulaires eux-mêmes et les plus vieux sénateurs, par un fonds de haine pour la puissance tribunitienne, dont le Peuple, à leur avis, désirait bien plus ardemment le retour que celui de
l'autorité consulaire, aimaient mieux, en quelque sorte, attendre que les décemvirs sortissent volontairement de charge, que de voir le Peuple, en haine des décemvirs, se Soulever de
nouveau.
Aux désastres causés par l'ennemi, les décemvirs ajoutent deux crimes affreux, l'un au camp, et l'autre dans
Rome. Lucius Siccius, qui servait dans l'armée dirigée contre les Sabins, exploitant la haine qui s'attachait aux décemvirs, engageait secrètement les soldats à rétablir les tribuns et à se
Révolter. On l'envoie reconnaître une position pour y placer un camp, et des soldats l'escortent, avec ordre de le tuer au premier endroit favorable. On annonça au camp que Siccius, malgré des
prodiges de valeur, a péri dans une embuscade, et quelques soldats avec lui.
On crut d'abord ceux qui rapportèrent ces nouvelles, mais très vite on ne douta plus que Siccius avait péri de la main des siens, et on rapporta son cadavre. L'irritation fut à son comble dans le
camp, et c'est à Rome qu'on voulait sur-le-champ transporter Siccius. Mais les décemvirs se hâtèrent de lui décerner des funérailles militaires aux frais de l'état. On l'ensevelit au milieu des
regrets des soldats et de l'exécration que le nom des décemvirs avait excitée parmi le Peuple.
La ville fut ensuite témoin d'un forfait enfanté par la débauche, et non moins terrible dans ses suites que le déshonneur et le suicide de Lucrèce, auquel les Tarquins durent leur expulsion de la
ville et du trône : comme si les décemvirs étaient destinés à finir pareil que les rois et à perdre leur puissance par les mêmes causes. Appius Claudius s'enflamma d'un amour criminel pour une
jeune plébéienne et la viola. Son père était l'exemple des Citoyens, l'exemple des soldats. Sa femme avait vécu comme lui, et ses enfants étaient élevés dans les mêmes principes. Il avait promis
sa fille, Virginie, à Lucius Icilius, ancien tribun, homme passionné, et qui plus d'une fois avait fait preuve de courage pour la cause du Peuple.
Les hommes, et surtout Icilius, n'ont de paroles que pour réclamer la puissance tribunitienne et l'appel au
Peuple ; toute leur indignation était pour la patrie. La multitude s'anime et par l'atrocité du crime, et dans l'espoir qu'il serait une occasion favorable de recouvrer sa Liberté. Le décemvir
cite Icilius, et, sur son refus de comparaître, ordonne qu'on l'arrête. Comme on ne laissait pas approcher ses appariteurs, lui-même, suivi d'une troupe de jeunes patriciens, perce la foule et
commande de le conduire dans les fers. On voyait déjà autour d'lcilius la multitude et les chefs de la multitude, Lucius Valérius et Marcus Horatius.
La Lutte s'engage furieuse. Le licteur du décemvir veut porter la main sur Valérius et Horatius : le Peuple brise les faisceaux. Appius monte à la tribune, Valérius et Horatius l'y suivent : le
Peuple les écoute et couvre de murmures la voix du décemvir. Déjà, au nom de l'autorité, Valérius ordonne aux licteurs de s'éloigner d'un simple Citoyen. Spurius Oppius, voulant prêter secours à
son collègue Appius, se précipite, d'un autre côté, sur la place, et voit l'autorité vaincue par la force. Il se décide enfin à convoquer le sénat. Ainsi, voyant que la plus grande partie des
patriciens désapprouvait la conduite des décemvirs, et, dans l'espoir que le sénat mettrait un terme à leur puissance, la multitude s'apaise. Le sénat fut d'avis qu'il ne fallait point irriter le
Peuple, et qu'on devait songer surtout à empêcher que l'arrivée de Verginius à l'armée n'excitât quelque mouvement.
On dépêche donc au camp, qui se trouvait alors sur le mont Vécilius, les plus jeunes sénateurs, pour recommander aux décemvirs d'arrêter à tout prix la Révolte parmi les soldats. Mais Verginius
(le père de Virginie) y avait excité une effervescence plus grande encore que celle qu'il avait laissée à Rome. Outre qu'il parut avec une escorte de quatre cents Citoyens que l'horreur de ces
indignités avait amenés de la ville avec lui, l'arme qu'il tenait toujours à la main, le sang dont il était couvert (il avait tué sa fille pour lui éviter de devenir esclave, ruse d'Appius pour
sauver son statut), attirent sur lui les regards. Les décemvirs, troublés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils apprennent de Rome, courent sur différents points du camp, calmer l'agitation. S'ils
emploient la douceur, on ne leur répond pas ; s'ils invoquent leur autorité, ils ont affaire à des hommes, et à des hommes armés.
Les soldats marchent en ordre vers la ville, et occupent l'Aventin. À mesure qu'on accourt, ils exhortent le Peuple à recouvrer sa Liberté et à créer des tribuns. Spurius Oppius convoque le sénat
: celui-ci se refuse à toute mesure violente, car les décemvirs eux-mêmes ont provoqué cette sédition. On envoie trois députés consulaires, Spurius Tarpéius, Gaius Julius, Publius Sulpicius,
demander, au nom du sénat : « En vertu de quels ordres les soldats ont quitté le camp ? Ce qu'ils prétendent faire en occupant armés le mont Aventin ? Ont-ils abandonné la guerre contre l'ennemi
pour s'emparer de leur patrie ? ». À ces questions les réponses ne manquaient point, mais il manquait quelqu'un pour les faire. On était encore sans chef avoué, personne n'osant s'exposer seul à
tant de haines. Seulement, un cri unanime s'éleva de la multitude ; elle demande qu'on lui envoie Lucius Valérius et Marcus Horatius : c'est eux qu'on chargera d'une réponse. Mais eux s'y
refusaient, à moins que les décemvirs ne déposassent les insignes de leur magistrature, expirée dès l'année précédente. Les décemvirs se plaignent qu'on les dégrade et protestent qu'ils ne
déposeront point leur autorité avant qu'on n'ait adopté les lois pour l'établissement desquelles on les avait créés.
Persuadé par les conseils de Marcus Duillius, ancien tribun, qu'il n'obtiendrait rien en prolongeant ces négociations, le Peuple passe de l'Aventin sur le mont Sacré : « tant qu'ils
n'abandonneront pas la ville, assurait Duillius, ils n'inspireraient au sénat aucune inquiétude ; le mont Sacré devait lui rappeler la constance du Peuple ; il saurait que le rétablissement de la
puissance tribunitienne peut seule ramener la Concorde, imitant la modération de leurs pères, et sans se livrer à aucune violence ». Le Peuple suivit l'armée, et pas un de ceux à qui l'âge le
permettait ne resta en arrière. À leur suite venaient leurs femmes, leurs enfants, demandant avec douleur pourquoi ils les laissaient dans une ville où la pudeur, la Liberté, rien n'y était
sacré. Déjà plusieurs voix, jointes à celles de Valérius et d'Horatius, s'écriaient :
« Qu'attendez-vous encore, sénateurs ? Si les décemvirs ne mettent pas une borne à leur obstination, souffrirez-vous que tout périsse dans une conflagration générale ? Est-ce pour les toits et
les murailles que vous ferez des lois ? N'avez-vous pas honte de voir dans le forum plus de vos licteurs que de Citoyens en toge ? Que ferez-vous si l'ennemi marche sur vous ? Que ferez-vous si
le Peuple, voyant sa retraite sans effet, se présente en armes ? La chute de Rome est-elle nécessaire pour amener celle de votre autorité ? Il faut vous passer du Peuple ou lui rendre ses
tribuns. Nous nous passerons plutôt, nous, de magistrats patriciens, que les Plébéiens des leurs. Ces reproches retentissent de toutes parts, et les décemvirs, vaincus par cette unanimité, s'en
remettent à la discrétion du sénat. Ils prient seulement et préviennent les sénateurs de les protéger contre la haine publique, pour que leur supplice n'accoutume pas ce Peuple à voir répandre le
sang des patriciens.
Alors Valérius et Horatius reçoivent mission de se rendre auprès du Peuple, de lui faire, pour son retour, les conditions qu'ils jugeront convenables, et de préserver les décemvirs de la haine et
de l'exécration de la multitude. C'étaient ses Libérateurs : leurs efforts avaient commencé le mouvement et allaient le terminer. Icilius parla au nom de tout le Peuple. Il exigeait le
rétablissement de la puissance tribunitienne et de l'appel au Peuple, qui, avant la création des décemvirs, étaient la sauvegarde du Citoyen, et une amnistie générale pour tous ceux qui avaient
engagé les soldats ou le Peuple à se retirer pour recouvrer leur Liberté. Les décemvirs seuls furent de sa part l'objet d'une demande cruelle. Les députés répondirent : « Les demandes que vous
avez délibérées en commun sont si justes, qu'on vous les eût de plein gré proposées : vous demandez des garanties pour votre Liberté et non la faculté de nuire à celle des autres. Votre
ressentiment se pardonne; mais on ne saurait l'autoriser. En haine de la cruauté, vous devenez cruels, et presque avant d'être Libres, vous voulez déjà tyranniser vos adversaires. Est-ce donc que
notre cité ne fera jamais trêve aux vengeances des patriciens contre le Peuple, ou du Peuple contre les patriciens ? Le bouclier vous convient mieux que l'épée. C'est assez, c'est bien assez
abaisser vos adversaires, que de les réduire à une Egalité parfaite de Droits, de leur ôter les moyens de nuire aux autres, en empêchant qu'on leur nuise. Aujourd'hui, il vous suffit de
revendiquer votre Liberté ».
-449 : Élection des tribuns de la Plèbe sur l'Aventin.
D'un accord unanime on s'en remet à la décision des députés qui promettent de revenir après avoir tout terminé. Ils vont exposer au sénat les conditions dont le Peuple les a chargés, et les
décemvirs voyant que, contre leur attente, il n'est question pour eux d'aucune peine, ne se refusent à rien. Un sénatus-consulte portait que les décemvirs abdiqueraient au plus tôt, que Quintus
Furius, grand pontife, nommerait des tribuns populaires, et qu'on ne rechercherait personne pour la Révolte de l'armée et du Peuple. Ces décrets achevés, les décemvirs lèvent la séance, se
rendent au forum, et prononcent leur abdication au milieu des plus vifs transports de joie.
Aussitôt, formés en comices et présidés par le grand pontife, les Citoyens nomment leurs tribuns, et en tête Lucius Verginius, après lui viennent Lucius Icilius et Publius Numitorius, oncle de
Virginie, auteurs de l'Insurrection, ensuite Gaius Sicinius, descendant de celui que la tradition regarde comme le premier tribun du Peuple élu sur le mont Sacré, et Marcus Duillius, qui s'était
fait remarquer dans la même charge avant la création des décemvirs, et dont l'appui n'avait pas manqué au Peuple dans sa Lutte contre eux.
Aussitôt, la création de deux consuls avec appel au Peuple fut décrétée sur la proposition de Marcus Duillius.
Un interroi nomma ensuite les consuls Lucius Valérius et Marcus Horatius, lesquels entrèrent aussitôt en fonction. Ce consulat populaire ne lésait en rien les droits des patriciens, et fut
cependant en butte à leur haine. Tout ce qui se faisait pour la Liberté du Peuple leur semblait une usurpation sur leur puissance. D'abord, il était un point de droit en contestation pour ainsi
dire permanente : il s'agissait de décider si les patriciens étaient soumis aux plébiscites. Les consuls portèrent dans les comices par centuries une loi déclarant que les décisions du Peuple
assemblé par tribus lieraient tous les Citoyens. On donnait ainsi aux tribuns l'arme la plus terrible. Une autre loi, émanée des consuls, rétablit l'appel au Peuple, unique soutien de la Liberté.
Le sort des Plébéiens était ainsi suffisamment assuré par l'appel au Peuple et l'appui du tribunat.
-445 : le tribun de la Plèbe Caius Canuleius obtient l'autorisation du mariage entre plébéien et patricien
(Lex Canuleia).
-444/-443 : les Plébéiens réclament l'Egalité politique. Les patriciens remplacent le consulat par le tribunat militaire avec pouvoir consulaire, accessible aux Plébéiens, et par la fonction de
censeur (recensement quinquennal des Citoyens romains par niveau de fortune ; ils inscrivent les nouveaux Citoyens romains dans les registres de leur centurie et de leur tribu, passent en revue
les chevaliers et sont chargés de mettre à jour l'album, c'est-à-dire le registre des personnes admises au sénat – leur fonction les amène également à surveiller les mœurs, ce qui leur permet de
rayer de l'album sénatorial les sénateurs indignes, mais aussi de flétrir publiquement la réputation d'une personne par la nota censoria) réservée aux patriciens.
-439 : Distributions illicites de blé et Révolte plébéienne, matée par le dictateur Cincinnatus (magistrature exceptionnelle qui attribuait tous les pouvoirs à un seul homme, le dictateur –
étymologiquement « celui qui parle » –; cette magistrature suprême, assortie de règles de désignation précises et temporaire – 6 mois maximum –, était accordée en cas de danger grave contre la
république ; elle fut abolie après les dictatures de Sylla et Jules César).
À cette époque Spurius Maelius, de l'ordre des chevaliers, et qui était prodigieusement riche pour le temps,
donna le dangereux exemple d'une chose utile en elle-même, mais dénaturée par ses détestables intentions : il avait, par l'entremise de ses hôtes et de ses clients, fait à ses frais des achats de
blé en Étrurie (ce qui rendit inutiles les mesures prises par l'état pour adoucir la disette). Il se mit à distribuer des grains au Peuple. Maelius porta encore plus haut ses vues trop
ambitieuses : voyant qu'il fallait arracher le consulat aux patriciens, il aspira au trône : c'était le seul prix digne de tant de combinaisons et de la lutte terrible qu'il allait soutenir.
Or Minucius, chargé par l'état des mêmes soins (intendant des vivres) que prenait Maelius de son propre mouvement, ayant découvert ce qui se passait, en avertit le sénat : « On portait des armes
dans la maison de Maelius, et lui-même y tenait des assemblées. Il avait évidemment le projet de se faire roi. Le moment de l'exécution n'était pas encore fixé; mais on avait arrêté tout le
reste. Des tribuns, gagnés à prix d'argent, avaient vendu la Liberté ; les chefs de la multitude s'étaient déjà partagé les emplois ».
Le lendemain, après avoir placé des corps de garde, il descend sur le forum, et étonne le Peuple par cet appareil inattendu. Maelius et ses partisans sentirent bien que c'était contre eux
qu'était dirigée la puissance de cette redoutable magistrature ; mais les Citoyens qui ignoraient leurs complots, se demandaient : « Quelle sédition, quelle guerre soudaine avait rendu nécessaire
l'autorité dictatoriale, ou avait fait confier la direction de la république à Quinctius Cincinnatus, qui était plus qu'octogénaire ? ».
Maelius se réfugie au milieu d'un groupe de ses complices. Enfin, sur l'ordre du chef de la cavalerie, un appariteur l'arrête. Délivré par les assistants, il s'enfuit en implorant le secours de
la multitude ; il dit que c'est une conspiration des patriciens qui l'opprime, parce qu'il a fait du bien au Peuple ; il le conjure de venir à son aide dans un danger si imminent, et de ne pas du
moins le laisser égorger sous ses yeux. Au milieu de ces clameurs, Ahala Servilius l'atteint et lui tranche la tête; puis, couvert de son sang, entouré d'une troupe de jeunes patriciens, il va
annoncer au dictateur que Maelius, cité devant lui, a repoussé l'appariteur, soulevé la multitude, et subi la peine due à son crime. Alors le dictateur : « Je te félicite de ton courage, Gaius
Servilius, lui dit-il : tu as sauvé la république ».
La Paix régna au-dedans et au-dehors cette année et la suivante, où furent consuls Gaius Furius Paculus et
Marcus Papirius Crassus. Ce fut alors que l'on célébra les Jeux que les décemvirs, sur un décret du sénat, avait voués lors de la retraite du Peuple. Vainement, Poetélius chercha l'occasion
d'exciter des troubles : il s'était fait nommer pour la seconde fois tribun du Peuple, en annonçant tout haut ses projets, mais il ne put obtenir que les consuls proposassent au sénat le partage
des terres, et, lorsque après de longs débats, il parvint à faire soumettre aux sénateurs la question de savoir si l'on tiendrait les comices pour la création de consuls ou de tribuns militaires,
il fut décidé que l'on nommerait des consuls.
-433/-432 : Luttes de la Plèbe pour obtenir le pouvoir.
Les tribuns du Peuple qui, dans leurs harangues continuelles, s'opposaient à la tenue des comices pour l'élection des consuls, et qui avaient presque amené la nécessité d'un interroi, obtinrent
enfin qu'on nommerait des tribuns militaires avec la puissance consulaire ; mais le fruit qu'ils espéraient de cette victoire, la nomination d'un Plébéien, leur échappa : tous les tribuns
militaires se trouvèrent des patriciens, Marcus Fabius Vibulanus, Marcus Folius, Lucius Sergius Fidénas. La peste fit taire pour cette année les dissensions publiques.
Mais toute décision fut ajournée à un an, et l'on défendit, par un décret, toute réunion avant cette époque.
Sur ces entrefaites, à Rome, les principaux Plébéiens, fatigués de poursuivre en vain depuis si longtemps l'espoir de plus grands honneurs, profitent de la tranquillité du dehors pour tenir des
assemblées dans la maison des tribuns du Peuple, et là ils dévoilent leurs pensées secrètes : « Ils se plaignent de l'indifférence du Peuple, qui est telle que, depuis tant d'années qu'on nomme
des tribuns militaires avec la puissance consulaire, pas un Plébéien n'a été encore promu à cet honneur. Leurs ancêtres, par une sage précaution, ont interdit aux patriciens les magistratures
plébéiennes, autrement, on aurait eu pour tribuns du Peuple des patriciens : tant ils obtiennent peu d'estime, même auprès des leurs, tant ils sont méprisés par le Peuple, aussi bien que par le
sénat ! » D'autres essaient d'excuser le Peuple, et rejettent la faute sur les patriciens : « C'est par leurs brigues et par leurs artifices que le chemin des honneurs est fermé aux Plébéiens.
S'ils laissaient respirer le Peuple, s'ils ne le poursuivaient pas de leurs prières et de leurs menaces, il se souviendrait de ses défenseurs en allant aux suffrages, et après s'être donné un
appui, s'emparerait du pouvoir ».
Pour arrêter la brigue, il fut décidé que les tribuns présenteraient une loi par laquelle il serait défendu à tous les candidats de rien ajouter à leur toge blanche. Cette mesure presque puérile,
et qui, aujourd'hui, n'est pas digne d'un examen sérieux, souleva alors de violents débats entre le sénat et le Peuple. Les tribuns l'emportèrent enfin, et leur loi passa. On pouvait prévoir, à
l'irritation des esprits, que la fureur du Peuple se porterait sur les siens; mais de peur qu'il n'usât de cette Liberté, un sénatus-consulte ordonna qu'on nomme des consuls.
-421 : Luttes entre Plébéiens et patriciens à propos de l'élection des questeurs et de la loi agraire : pour
la première fois, un Plébéien devient questeur (gardiens du Trésor, chargés des finances de l'armée et des provinces).
La faveur avec laquelle les discours étaient accueillis engagea quelques Plébéiens à briguer le tribunat militaire, et chacun d'eux annonçait les lois qu'il proposerait pendant sa magistrature, à
l'avantage du Peuple. On lui faisait entrevoir, pour le gagner, un partage des terres, une fondation de colonies, un impôt levé sur les propriétaires-fermiers, et dont le produit serait employé à
la solde des troupes.
Mais si à la guerre la lutte avait été moins acharnée qu'on ne l'avait craint d'abord, dans la ville, au contraire, du sein d'une Paix profonde surgit tout à coup, entre le Peuple et le sénat, un
amas de discordes, au sujet des questeurs dont on voulait doubler le nombre. Les consuls en avaient fait la proposition, et les sénateurs l'appuyaient de tout leur pouvoir, quand les tribuns du
Peuple s'établirent en lutte ouverte contre les consuls, pour qu'une partie des questeurs, jusque-là choisis parmi les patriciens, fût prise dans le Peuple. Les consuls et les sénateurs
commencèrent par repousser de toutes leurs forces cette prétention ; ensuite ils accordèrent qu'on suivrait le même mode que pour l'élection des tribuns consulaires, et que le Peuple serait libre
de choisir les questeurs dans l'une et l'autre classe, mais cette concession ayant eu peu de succès, ils abandonnèrent entièrement le projet d'augmenter le nombre des questeurs.
Les tribuns le reprennent et soulèvent à ce propos plusieurs motions séditieuses, entre autres un projet de loi agraire. Au milieu de ces agitations, le sénat eût mieux aimé nommer des consuls
que des tribuns. Mais les oppositions tribunitiennes rendant tout sénatus-consulte impossible, à la fin de ce consulat, la république en revint à un interroi, encore eut-elle de la peine à
l'obtenir, car les tribuns empêchaient les patriciens de s'assembler.
À la fin, Lucius Papirius Mugillanus, élu interroi, attaqua avec force sénateurs et tribuns du Peuple. Il fallait des deux côtés abandonner une partie de leurs droits, et travailler à ramener la
Concorde : les patriciens, en permettant que l'on créât des tribuns militaires au lieu de consuls ; les tribuns du Peuple, en ne s'opposant plus à ce que les quatre questeurs fussent
indifféremment choisis parmi les Plébéiens et les patriciens par le Libre suffrage du Peuple.
-418 / -416 : Prise de Labicum, retour de l'Agitation à Rome (-417/-416)
Le dictateur ramena dans Rome l'armée victorieuse; et, le huitième jour après sa nomination, il abdiqua sa magistrature. Aussitôt le sénat, pour que les tribuns du Peuple n'eussent pas le temps
de porter quelque proposition séditieuse, relative au partage des terres, à l'occasion du Labicum, décréta, en assemblée nombreuse, qu'on enverrait une colonie à Labicum : quinze cents colons,
envoyés de la ville, reçurent chacun deux arpents.
Durant deux années, tout fut tranquille au-dehors, mais au-dedans il y eut du trouble à l'occasion de lois agraires.
Les agitateurs de la multitude étaient les Spurius Maecilius et Marcus Métilius, tribuns du Peuple, celui-ci pour la troisième fois, celui-là pour la quatrième, tous deux nommés en leur absence.
Ils avaient émis une proposition pour la répartition Egale et par tête des terres prises à l'ennemi, et comme, par suite de ce plébiscite, les biens des nobles eussent été déclarés biens de
l'état (car la ville, bâtie sur le sol étranger, ne possédait pas un coin de terre qui n'eût été conquis par les armes, et le Peuple n'avait guère que ce qui lui avait été vendu ou assigné par la
république), une guerre à outrance devint imminente entre le Peuple et les patriciens. Les tribuns militaires, convoquant tantôt le sénat, tantôt des assemblées particulières des principaux
sénateurs, ne voyaient pas comment sortir de l'impasse.
Alors Appius Claudius, petit-fils de celui qui avait été décemvir pour la rédaction des lois, et le plus jeune dans l'assemblée des sénateurs, leur dit « qu'il apportait de sa maison un vieil
expédient de famille, car son bisaïeul, Appius Claudius, avait enseigné aux sénateurs le seul moyen d'anéantir la puissance des tribuns, qui est de mettre de l'opposition parmi eux. Les hommes
nouveaux sacrifient assez volontiers leur opinion à l'autorité des grands, surtout quand ceux-ci, oubliant leur supériorité, se contentent de mettre en avant les circonstances. L'intérêt seul les
anime : dès qu'ils verront que leurs collègues, auteurs de la proposition, ont usurpé toute faveur dans l'esprit du Peuple, sans leur y laisser une place, ils inclineront fortement vers le parti
du sénat, pour se concilier l'ordre entier par les premiers d'entre ses membres ». Tous ayant approuvé, et particulièrement Quintus Servilius Priscus, qui loua le jeune homme de n'avoir point
dégénéré de la race des Claudius, il fut décidé que chacun travaillerait, selon ses moyens, à détacher des tribuns quelques-uns de leurs collègues pour les leur opposer.
La séance levée, les premiers du sénat s'emparent des tribuns, et après leur avoir persuadé, démontré, promis qu'ils feraient chose agréable à chacun d'eux, agréable à tout le sénat, ils
obtiennent six voix pour l'opposition. Le jour suivant, comme, d'après le plan arrêté, on avait fait un rapport au sénat sur la sédition que Maecilius et Métilius excitaient par une largesse d'un
si funeste exemple, les principaux sénateurs, tenant tous le même langage, répètent à l'envi qu'ils n'imaginent aucune mesure suffisante, et qu'ils ne voient de salut que dans le recours à
l'assistance des tribuns. La république opprimée a foi en leur puissance, et, comme un Citoyen qu'on dépouille, elle cherche auprès d'eux un refuge. N'est-ce pas une gloire pour eux et pour la
puissance tribunitienne, de montrer que si le tribunat est assez fort pour tourmenter le sénat et pour soulever des querelles entre les divers ordres, il n'a pas moins de force pour résister à de
mauvais collègues ?
Un murmure d'approbation s'éleva dans le sénat, tandis que de tous les côtés de l'assemblée on invoque les tribuns. Alors on fait silence, et ceux que les séductions des grands avaient gagnés
déclarent que, puisque dans la pensée du sénat la demande de leurs collègues ne tend qu'à dissoudre la république, ils s'opposent. Les auteurs du projet, ayant convoqué une assemblée, proclament
leurs collègues traîtres aux intérêts du Peuple, esclaves des consulaires, et, après les avoir accablés d'autres invectives, retirent leur proposition.
-413 : Élections consulaires, élection de trois questeurs Plébéiens (-409), élection des tribuns militaires
(-408).
Le moment eût été bien choisi, après avoir frappé les séditions, de proposer, pour calmer les esprits, le partage du territoire de Bola : on eût affaibli par là tout désir d'une loi agraire qui
devait chasser les patriciens des héritages publics injustement usurpés. Le Peuple était alors vivement préoccupé de cette indignité avec laquelle la noblesse s'acharnait à retenir les terres
publiques qu'elle occupait de force, et surtout de son refus de partager avec lui, même les terrains vagues pris naguère sur l'ennemi, et qui deviendraient bientôt, comme le reste, la proie de
quelques patriciens.
On créa consuls Gnaeus Cornélius Cossus et Lucius Furius Médullinus, celui-ci pour la seconde fois. Jamais le
Peuple ne s'était vu fermer avec plus de douleur les comices tribunitiens. Il montra sa colère et se vengea dans les comices pour l'élection des questeurs, où pour la première fois il choisit des
questeurs parmi les Plébéiens ; de sorte que sur quatre nominations, un seul patricien, Gaius Fabius Ambustus trouva place, trois Plébéiens, Quintus Silius, Publius Aelius, Publius Pupius furent
préférés aux jeunes gens des plus illustres familles. Ces choix hardis furent imposés au Peuple par les Icilius, de famille ennemie déclarée des patriciens.
Les patriciens, de leur côté, murmuraient, non du partage, mais de la perte de leurs honneurs : « S'il en est ainsi, disaient-ils, à quoi bon élever des enfants, qui, repoussés du rang de leurs
ancêtres, verront des étrangers maîtres de leur dignité, et qui n'ayant plus d'autre ressource que de se faire saliens ou flamines, pour sacrifier au nom du Peuple, demeureront dépouillés des
commandements et des magistratures ? ».
Les esprits s'étaient aigris des deux côtés. Comme le Peuple avait pris de l'audace et que la cause populaire était aux mains de trois chefs d'une immense célébrité, les patriciens, prévoyant que
toutes les élections où le Peuple avait son Libre suffrage auraient le même résultat que celle des questeurs, demandaient les comices consulaires qui étaient fermés au Peuple. Les Icilius, au
contraire, voulaient une nomination de tribuns militaires, en disant que le Peuple devait enfin avoir sa part des honneurs publics.
À Rome, le Peuple eut l'avantage dans le choix des comices, mais, quant au résultat des comices, l'avantage
demeura aux patriciens. En effet, contre l'attente générale, on nomma pour tribuns militaires, avec puissance de consuls, trois patriciens, Gaius Julius Iulus, Publius Cornélius Cossus, Gaius
Servilius Ahala. Les patriciens usèrent d'une ruse que les Icilius eux-mêmes leur reprochèrent à cette époque : ce fut de confondre les plus dignes Citoyens au milieu d'une tourbe de candidats
indignes, qui, pour la plupart, portaient de telles marques de souillures, que le Peuple s'éloigna par dégoût des Plébéiens.
-390 : défaite romaine à l'Allia contre les Gaulois menés par Brennus. Les vestales et les prêtres sont mis
en sécurité dans la ville étrusque de Caere (Cerveteri), Rome est mise à sac, des sénateurs restés sur place sont massacrés. Résistance de Manlius Capitolinus sur le Capitole (Episode des oies du
Capitole). Brennus évacue Rome contre rançon. (formule du Vae Victis).
-384 : accusé d'aspirer à la royauté, Manlius Capitolinus est précipité du haut de la roche Tarpéienne.
-375 à -370 : blocage politique à Rome, les tribuns de la Plèbe Lucius Sextius Lateranus et Caius Licinius Stolon empêchent la tenue des élections tant que leur projet de loi n'est pas soumis au
vote du Peuple.
À mesure que les succès militaires de cette année rétablissaient partout la Paix au-dehors, dans la ville
croissaient de jour en jour et la violence des patriciens et les misères du Peuple, auquel on ôtait tout pouvoir de payer ses dettes, en s'obstinant à l'y contraindre. Une fois donc leur
patrimoine épuisé, ce fut leur honneur et leur corps (à l'obligation de dette s'étaient substitués) que les débiteurs, condamnés et adjugés, livrèrent en paiement à leurs créanciers. Une telle
dépendance avait abattu les esprits et des plus humbles et des plus distingués Plébéiens ; et si bien, qu'ils ne cherchaient plus non seulement à disputer aux patriciens le tribunat militaire, ce
prix de tant de Luttes et de travaux jadis, mais même à solliciter ou à prendre en main les magistratures plébéiennes. Mais pour troubler l'extrême joie de ce parti, survint un léger incident,
qui amena (comme souvent il arrive) de graves événements.
M. Fabius Ambustus, homme puissant parmi les membres de son ordre et même auprès du Peuple, qui savait n'être point méprisé de lui, avait marié ses deux filles, l'aînée à Ser. Sulpicius, la plus
jeune à C. Licinius Stolon, homme distingué, Plébéien toutefois; et cette alliance même, que Fabius n'avait pas dédaignée, lui avait mérité la faveur de la multitude. Un jour, il arriva que,
pendant que les deux sœurs, réunies au logis de Ser. Sulpicius, tribun militaire, passaient le temps, comme d'ordinaire, à converser ensemble, Sulpicius revenait du Forum et rentrait chez lui :
le licteur heurta la porte, suivant l'usage, avec sa baguette ; à ce bruit, la jeune Fabia, étrangère à cet usage, s'effraya : sa sœur se prit à rire, étonnée de son ignorance. Elle avait
l'esprit encore troublé de cette récente blessure, quand son père la vit, et lui demanda si elle était malade. Elle déguisait le motif d'un chagrin qui n'était ni assez bienveillant pour sa sœur,
ni fort honorable pour son mari, mais il lui arracha enfin l'aveu que le motif de son chagrin n'était autre que l'inégalité de cette union qui l'avait alliée à une maison où les honneurs et le
crédit ne pouvaient entrer. Ambustus consola sa fille, lui commanda d'avoir bon courage : bientôt elle verrait chez elle ces mêmes honneurs qu'elle avait vus chez sa sœur. Il commença dès lors à
se concerter avec son gendre, après s'être associé L. Sextius, jeune homme de cœur, auquel il ne manquait, pour aspirer à tout, qu'une origine patricienne.
Un prétexte se présentait de tenter des nouveautés, c'était la masse énorme des dettes ; le Peuple ne devait
espérer de soulagement à ce mal qu'en plaçant les siens au sommet du pouvoir : c'est à ce but qu'il fallait tendre. À force d'essayer et d'agir, les Plébéiens avaient déjà fait un grand pas ;
quelques efforts de plus, et ils arriveraient au faîte, et ils pourraient égaler en dignités ces patriciens qu'ils égalaient en mérite. D'abord ils avisèrent de se faire nommer tribuns du Peuple
: cette magistrature leur ouvrirait la voie aux autres dignités.
Créés tribuns, C. Licinius et L. Sextius proposèrent plusieurs lois, toutes contraires à la puissance patricienne et favorables au Peuple – la première sur les dettes – on déduirait du capital
les intérêts déjà reçus, et le reste se paierait en trois ans par portions égales ; une autre limitait la propriété, et défendait à chacun de posséder plus de cinq cents arpents de terre ; une
troisième enfin supprimait les élections de tribuns militaires, et rétablissait les consuls, dont l'un serait toujours choisi parmi le Peuple : projets immenses, et qui ne pouvaient réussir sans
les plus violentes Luttes. C'était attaquer à la fois tout ce qui fait l'objet de l'insatiable ambition des humains : la propriété, l'argent, les honneurs.
Épouvantés, tremblants, les patriciens, après plusieurs réunions publiques et privées, ne trouvant point d'autre remède que cette opposition tribunicienne éprouvée tant de fois déjà dans des
luttes antérieures, engagèrent des tribuns du Peuple à combattre les projets de leurs collègues. Ces tribuns, le jour où ils virent les tribus citées par Licinius et Sextius pour donner leurs
suffrages, parurent, soutenus d'un renfort de patriciens, et ne permirent ni la lecture des projets de lois, ni aucune des autres formalités en usage pour un plébiscite. Plusieurs assemblées
furent convoquées encore, mais sans succès : les projets de lois semblaient repoussés. « C'est bien, dit alors Sextius, puisque l'opposition de nos collègues a ici tant de force, ce sera notre
arme aussi pour la défense du Peuple.
Ces menaces ne furent pas vaines : aucune élection, hors celles des édiles et des tribuns du Peuple, ne put réussir. Licinius et Sextius, réélus tribuns du Peuple, ne laissèrent créer aucun
magistrat curule, et comme le Peuple renommait toujours les deux tribuns, qui toujours repoussaient les élections de tribuns militaires, la ville demeura cinq ans dépossédée de ses
magistrats.
Partout, heureusement, la guerre dormait. De plus violents combats s'élevaient dans Rome. De concert avec
Sextius et Licinius, qui avaient proposé les projets de lois, et qu'on avait renommés huit fois déjà tribuns du Peuple, un tribun militaire, beau-père de Stolon, Fabius, premier auteur de ces
lois, s'en proclamait sans hésiter le défenseur. Dans le collège des tribuns du Peuple, il s'était trouvé d'abord huit opposants ; il en restait cinq encore, et ces tribuns (comme presque
toujours ceux qui trahissent leur parti), embarrassés, interdits, n'appuyaient leur opposition que de cette leçon que des voix étrangères, à domicile, leur avaient apprise : « Une grande partie
du Peuple est loin de Rome, à l'armée, devant Vélitres. Jusqu'au retour des soldats, on doit différer les comices, afin que tout le Peuple puisse voter sur ses
intérêts ».
Sextius et Licinius au contraire, soutenus de leurs collègues et du tribun militaire Fabius, et devenus, par une expérience de tant d'années déjà, habiles à manier les esprits de la multitude,
prenaient à partie les chefs des patriciens et les fatiguaient de questions sur chacune des lois proposées au Peuple : oseraient-ils réclamer, quand on distribuait deux arpents de terre aux
Plébéiens, la Libre jouissance pour eux de plus de cinq cents arpents ? chacun d'eux posséderait-il les biens de près de trois cents Citoyens, quand le Plébéien aurait à peine assez d'espace en
son champ pour un logis bien juste, ou la place de sa tombe! Leur plairaient-ils donc à voir le Peuple écrasé par l'usure, et forcé, quand le paiement du capital devrait l'acquitter, de livrer
son corps aux verges et aux supplices? et chaque jour, les débiteurs adjugés, traînés en masse loin du Forum? et les maisons des patriciens remplies de prisonniers, et, partout où demeure un
noble, un cachot pour des Citoyens?
-369 : Les tribuns de la Plèbe demandent qu'un des consuls soit obligatoirement choisi dans la Plèbe.
Après avoir ainsi tonné contre ces déplorables abus devant la multitude tremblant pour elle-même, et plus indignée que les tribuns, ils poursuivaient, affirmant que les patriciens ne cesseraient
d'envahir les biens du Peuple, de le tuer par l'usure, si le Peuple ne tirait de lui-même un consul, gardien de sa Liberté. « On méprise désormais les tribuns du Peuple : cette puissance a brisé
ses forces avec son opposition. L'Egalité est impossible quand pour ceux-là est l'empire, pour les tribuns le seul droit de défense : si on ne l'associe à l'empire, jamais le Peuple n'aura sa
juste part de pouvoir dans l'état. Personne ne peut se contenter de l'admission des Plébéiens aux comices consulaires ; si on ne fait une nécessité de toujours prendre un des consuls parmi le
Peuple, jamais on n'aura de consul Plébéien. A-t-on donc oublié déjà que, depuis qu'on s'était avisé de remplacer les consuls par des tribuns militaires, afin d'ouvrir au Peuple une voie aux
dignités suprêmes, pas un Plébéien, pendant quarante-quatre ans, n'avait été nommé tribun militaire? Il faut emporter par une loi ce que le crédit ne peut obtenir aux comices, mettre hors de
concours un des deux consulats, pour en assurer l'accès au Peuple : s'ils restent au concours, ils seront toujours la proie du plus puissant. Les patriciens ne peuvent plus dire à cette heure ce
qu'ils allaient répétant sans cesse, qu'il n'y avait pas dans les Plébéiens d'hommes propres aux magistratures curules. La république a-t-elle donc été plus mollement ou plus sottement servie
depuis P. Licinius Calvus, premier tribun tiré du Peuple, que durant ces années, où nul autre qu'un patricien ne fut tribun militaire? Au contraire, on a vu des patriciens condamnés après leur
tribunat, jamais un Plébéien. Les questeurs aussi, comme les tribuns militaires, sont, depuis quelques années, choisis parmi le Peuple, et pas une seule fois le Peuple romain ne s'en est repenti.
Le consulat manque seul aux Plébéiens : c'est le dernier rempart, c'est le couronnement de la Liberté. Si on y arrive, alors le Peuple romain pourra vraiment croire les rois chassés de la ville
et sa Liberté affermie. Car de ce jour viendront au Peuple toutes ces distinctions qui grandissent tant les patriciens : l'autorité, les honneurs, la gloire des armes, la naissance, la noblesse,
biens immenses pour eux-mêmes, et qu'ils lègueront plus immenses à leurs enfants ».
Dès les premiers jours de l'année, on en vint à la lutte dernière au sujet des lois ; et comme leurs auteurs avaient convoqué les tribus sans s'arrêter à l'opposition de leurs collègues, les
patriciens alarmés recoururent aux deux remèdes extrêmes, au premier pouvoir, au premier Citoyen de Rome. Ils résolurent de nommer un dictateur, et nommèrent M. Furius Camille, qui choisit pour
maître de la cavalerie L. Aemilius.
De leur côté, les auteurs des lois, en présence de ces redoutables préparatifs de leurs adversaires, arment de grands courages la cause du Peuple : l'assemblée de la Plèbe convoquée, ils
appellent les tribus aux votes. Le dictateur, environné d'une troupe de patriciens, plein de colère et de menaces, prend place au Forum : l'affaire s'engage par cette première Lutte des tribuns
du Peuple qui proposent la loi, et de ceux qui s'y opposent ; mais si l'opposition l'emportait par le droit, elle était vaincue par le crédit des lois et de leurs auteurs. Alors Camille :
« Puisque désormais, Romains, dit-il, c'est le caprice des tribuns, et non plus la souveraineté du tribunat qui fait loi pour vous, et que ce droit d'opposition, cette antique conquête de la
retraite du Peuple, vous l'anéantissez aujourd'hui par les mêmes voies qui vous l'ont acquis, dans l'intérêt de la république tout entière, non moins que dans le vôtre, je viendrai, dictateur, en
aide à l'opposition, et ce droit, qui est à vous et qu'on détruit, mon autorité le protégera. Si donc C. Licinius et L. Sextius cèdent à l'intervention de leurs collègues, je n'interposerai point
la magistrature patricienne dans une assemblée populaire, mais si, en dépit de l'intervention, ils prétendent imposer ici des lois comme dans une ville prise, je ne souffrirai point que la
puissance tribunicienne s'anéantisse elle-même ».
Au mépris de ces paroles, les tribuns du Peuple n'en poursuivent pas moins vivement leur opération. Transporté de colère, Camille envoie des licteurs dissiper la foule, et menace, si on persiste,
de contraindre toute la jeunesse au serment militaire, et d'emmener à l'instant cette armée hors de la ville. Il avait imprimé au Peuple une grande terreur ; quant aux chefs, son attaque avait
plutôt enflammé qu'abattu leur courage.
Mais, avant que le succès se fût décidé de part ou d'autre, il abdiqua sa magistrature.
Entre l'abdication du premier dictateur et l'entrée de Manlius en fonctions, les tribuns profitèrent d'une espèce d'interrègne pour convoquer une assemblée du Peuple. On put voir alors celles des
propositions que préférait le Peuple et celles que préféraient leurs auteurs. Il acceptait les lois sur l'usure et les terres, et repoussait le consulat Plébéien, et il allait se prononcer
séparément sur l'une et l'autre affaire, si les tribuns n'eussent réclamé pour le tout une seule et même décision. P. Manlius, le dictateur, fit pencher ensuite le succès vers la cause du Peuple,
en nommant maître de la cavalerie le Plébéien C. Licinius, qui avait été tribun militaire. Le sénat en fut mécontent : le dictateur s'excusa auprès des sénateurs sur la parenté qui l'unissait à
Licinius, et nia en même temps que la dignité de maître de la cavalerie fût supérieure à celle de tribun consulaire.
-367 : fin de la période des tribuns militaires à pouvoir consulaire : les tribuns de la Plèbe Lucius Sextius
Lateranus et Caius Licinius Stolon font enfin voter leur loi qui rétablit le consulat avec obligatoirement un consul plébéien ; création en réaction des fonctions de préteur et d'édile curule,
réservées aux patriciens.
Licinius et Sextius, une fois fixée la date des comices pour l'élection des tribuns du Peuple, déclarèrent : « Depuis neuf ans déjà, nous sommes là comme en bataille contre la noblesse, et
toujours à notre très grand risque personnel, sans aucun profit pour la république ; avec nous ont vieilli déjà et les lois que nous avons proposées et toute la vigueur de la puissance
tribunicienne. On a combattu nos lois d'abord par l'intervention de nos collègues, puis par l'envoi de la jeunesse à la guerre de Vélitres; enfin la foudre dictatoriale s'est dirigée contre nous.
Maintenant que ni nos collègues ni la guerre ne font obstacle, ni le dictateur, qui même a présagé le consulat au Peuple en nommant un Plébéien maître de la cavalerie, c'est le Peuple qui se nuit
à lui-même et à ses intérêts. Il peut tenir la ville et le Forum libres de créanciers, les champs libres de leurs injustes maîtres, et sur l'heure, s'il le veut. Mais ces bienfaits, quand donc
enfin les saura-t-il assez reconnaître et apprécier ? Il serait peu délicat au Peuple romain de revendiquer l'allègement de ses dettes et sa mise en possession de terres injustement usurpées par
les grands, pour laisser là, vieillards tribunitiens, sans honneurs, sans espoir même des honneurs, ceux qui l'auraient servi. Il doit donc déterminer d'abord en son esprit ce qu'il veut, puis
aux comices tribunitiens déclarer sa volonté. Si on veut accueillir conjointement toutes les lois proposées, on peut réélire les mêmes tribuns du Peuple, car ils poursuivront leur œuvre ; si, au
contraire, on ne veut accepter que ce qui peut servir l'intérêt privé de chacun, ils n'ont que faire d'être maintenus dans une dignité si mal voulue : ils n'auront point le tribunat, ni le peuple
les lois proposées ».
Le discours d'Appius ne réussit qu'à différer pour un temps l'acceptation des lois. Réélus tribuns pour la
dixième fois, Sextius et Licinius firent admettre la loi qui créait pour les cérémonies sacrées des décemvirs en partie Plébéiens. On en choisit cinq parmi les patriciens et cinq parmi le Peuple
: c'était un pas de fait dans la voie du consulat. Content de cette victoire, le Peuple accorda aux patriciens que, sans parler de consuls pour le moment, on nommerait des tribuns
militaires.
-366 : Lucius Sextius Lateranus est le premier Plébéien élu consul. Le sénat doit valider son élection sous
la menace d'une sécession populaire.
À peine eut-il mis fin à une guerre contre les Gaulois, qu'une plus atroce sédition accueillit le dictateur dans Rome. Après de violents débats, où le dictateur et le sénat succombèrent, on
adopta les lois tribuniciennes ; puis, en dépit de la noblesse, s'ouvrirent des élections consulaires, et là, pour la première fois, un Plébéien, L. Sextius, fut créé consul. Les débats n'étaient
point encore à leur terme. Les patriciens refusaient d'approuver l'élection, et le Peuple faillit en venir à une retraite, après avoir fait d'ailleurs d'effroyables menaces de guerre civile.
Cependant le dictateur présenta des conditions qui apaisèrent les discordes ; la noblesse accordait au Peuple un consul Plébéien, et le Peuple à la noblesse un préteur, qui administrerait la
justice dans Rome et serait patricien.
Les longues querelles cessèrent enfin, et la Paix revint parmi les ordres.
-364 : pour la première fois, un Plébéien, devient édile curule.
-356 : pour la première fois, un Plébéien, Caius Marcius Rutilus devient dictateur. Indignés, les patriciens refusent l'élection de consul plébéien, jusqu'à ce que l'agitation populaire l'impose
de nouveau en -352.
Les patriciens l'année suivante, sous le consulat de C. Marcius et de Cn. Manlius, les tribuns du Peuple M. Duilius et L. Menenius présenter, sur l'intérêt à un pour cent, une loi que le Peuple,
au contraire, accueillit et adopta avec empressement.
Quatre cents ans après la fondation de la ville de Rome, trente-cinq ans après sa délivrance des Gaulois,
onze ans après la conquête du consulat par le Peuple, deux consuls patriciens, C. Sulpicius Peticus pour la troisième fois, et M. Valerius Publicola, entrèrent ensemble en fonctions à la suite
d'un interrègne.
À Rome, les consuls eurent une plus rude guerre à faire au Peuple et aux tribuns. Ils pensaient que leur foi, plus que leur honneur encore, était engagée à remettre à deux patriciens ce consulat
que deux patriciens avaient reçu : on devait ou le céder totalement, si on faisait de ce consulat une magistrature plébéienne, ou le posséder totalement, suivant l'entière et pleine possession
qu'ils en avaient reçue de leurs pères.
De son côté, le Peuple murmurait : « Pourquoi vivre et se faire compter au rang de Citoyens, si un droit que deux hommes, L. Sextius et C. Licinius, ont acquis par leur courage, tous ensemble ils
ne peuvent le conserver ? Plutôt subir des rois, des décemvirs, toute autre domination plus odieuse encore, que de voir deux patriciens consuls, sans alternative d'obéissance et de commandement,
afin qu'un parti éternellement établi au pouvoir s'imagine que le Peuple n'est jamais né que pour servir ».
Les auteurs de tout désordre, les tribuns, sont là, mais, dans ce Soulèvement universel, les chefs se distinguent à peine. Plus d'une fois, sans succès, on descendit au Champ de Mars ; plusieurs
jours de comices s'usèrent en séditions. Enfin, vaincu par la persévérance des consuls, le Peuple laissa éclater une si vive douleur, que les tribuns criant : « C'en est fait de la Liberté, il
faut abandonner et le Champ de Mars et la ville même, captive et esclave sous la tyrannie des
patriciens » ; la multitude affligée les suivit. Les consuls, ainsi délaissés par une partie des Citoyens, continuèrent, sans se déconcerter, les comices dans cette assemblée incomplète.
Le Peuple romain n'était point si heureux dans la ville que dans les camps, car, bien que la réduction de l'intérêt à un pour cent eût allégé l'usure, le capital encore écrasait le pauvre, qui
tombait en servitude. Aussi, ni l'élection de deux consuls patriciens, ni le souci des comices et de ses intérêts publics, rien ne put détourner le Peuple du soin de ses douleurs
privées.
-351 : arbitrage de nombreuses dettes populaires. Nouvelle tentative d'écarter les Plébéiens du consulat. En
réaction populaire, Caius Marcius Rutilus devient censeur pour la première fois.
À la fin de l'année, les débats des patriciens et du Peuple interrompirent les comices consulaires : les tribuns refusaient de consentir à la tenue des comices, si les élections n'étaient
conformes à la loi Licinia, et le dictateur obstiné eût plutôt détruit à jamais le consulat dans la république, que de le partager entre les patriciens et le Peuple. D'ajournement en ajournement
des comices, le terme de la dictature expira et on en revint à l'interrègne. Les interrois trouvèrent le Peuple indigné contre les patriciens, et la Lutte, accompagnée d'Emeutes, dura jusqu'au
onzième interroi. Les tribuns mettaient sans cesse en avant la défense de la loi Licinia, alors que le Peuple était plus touché de voir s'aggraver ses dettes, et les douleurs privées éclataient
dans les débats publics. Lassé par ces querelles, le sénat ordonna, pour le bien de la Paix, à l'interroi L. Cornelius Scipion, de suivre la loi Licinia dans les comices consulaires. Après ce
premier retour des esprits vers la Concorde, les nouveaux consuls essayèrent d'alléger aussi la charge de l'intérêt des dettes, qui semblait un obstacle à une entière union. De la liquidation des
dettes, ils firent une charge publique, en créant des quinquévirs, auxquels leur mission de répartition pécuniaire valut le nom de « banquiers ». C'était là une opération difficile, qui
mécontente souvent les deux parties, et toujours l'une d'elles ; mais, grâce à la modération qu'ils montrèrent, et par une avance plutôt que par un abandon des fonds publics, ils réussirent. On
dressa dans le Forum des comptoirs avec de l'argent : le trésor paya après avoir pris toutes sûretés pour l'état, ou bien une estimation à juste prix et une cession libéraient le débiteur. Ainsi,
sans injustice, sans une seule plainte d'aucune des parties, on acquitta un nombre immense de dettes.